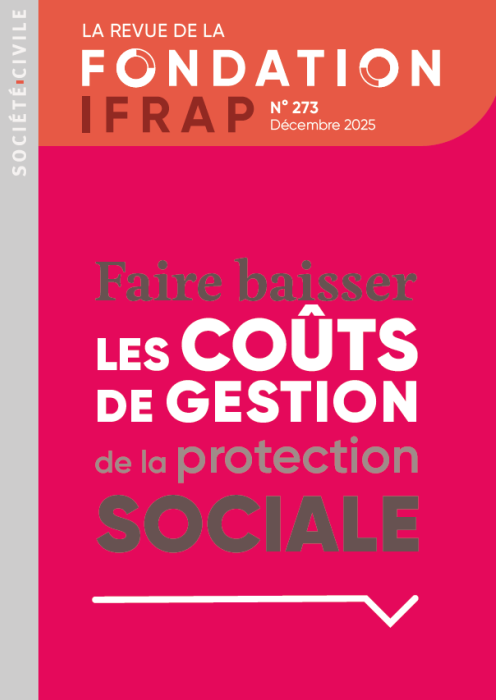Le Comité de Suivi des Retraites (CSR) met en garde sur une suppression de la réforme des retraites

Chaque année dans la foulée du rapport du COR, le CSR rend son avis sur la soutenabilité du système de retraite et énonce si besoin des recommandations s’il considère que le système de retraites s’éloigne des objectifs fixés par la loi [1]. Alors que la réforme des retraites de 2023 et son report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite reste la principale pierre d’achoppement entre les partis politiques et l’enjeu d’une éventuelle censure, le dernier rapport du CSR appelle à ramener le système de retraites sur une trajectoire d’équilibre et recommande de ne pas revenir sur les bornes d’âge de 2023, de ne surtout pas toucher à la réforme des retraites en sommes, et met en garde contre l'usage excessif de la désindexation. Sera-t-il entendu ?
Comme chaque année, le CSR a rendu son avis en juillet dans une relative discrétion. Ce comité créé par la réforme de 2014 sur les retraites, portée par F. Hollande et M. Touraine, s’appuie sur le rapport du COR et s’il constate « une divergence significative par rapport aux objectifs fixés au système de retraite – objectifs de pérennité financière, objectifs d’équité entre les générations et au sein de chaque génération, équité hommes-femmes et entre les régimes, niveau de pensions suffisant et cohérent avec l’effort contributif fourni – le CSR doit remettre au Gouvernement, au Parlement et aux régimes de retraite des recommandations. Dans son dernier avis, justement le CSR tire plusieurs signaux d’alerte :
1/ Un risque de sous-estimation des dépenses de retraite
Le CSR souligne que les dépenses de retraite resteraient stables dans les projections du COR à 14% du PIB. Un chiffre qui s’explique par la progression des dépenses des retraites du secteur privé (base et complémentaire) et la diminution de la part des dépenses de retraites publiques dans le PIB (de 2,2 % en 2025 à 1,3 % en 2070 pour les retraites des fonctionnaires d’État). Mais que ce soit pour le privé comme le public, le CSR questionne ces évolutions issues des conventions retenues par le COR :
S’agissant de la fonction publique, les projections reposent sur des « hypothèses conventionnelles qui gagneraient à être davantage explicitées et objectivées », dit le CSR. Les hypothèses reposent sur l’évolution du nombre de fonctionnaires – stable jusqu’en 2040 - et sur la rémunération moyenne et notamment le partage entre le traitement indiciaire et les primes. Rappelons que la retraite des fonctionnaires est calculée en % du traitement indiciaire. Plus le poids des primes augmente dans la rémunération, plus le taux de remplacement baisse. Ces hypothèses sont établies par la direction du budget. Elles concluent à une forte baisse d’ici 2037 de la rémunération relative des fonctionnaires par rapport aux salariés du secteur privé, et de la part du traitement indiciaire dans la rémunération totale. Le CSR estime que l’impact des hypothèses sur ces deux dimensions devrait être davantage « objectivé ». En effet, comme l’a montré la Fondation IFRAP, la fonction publique a encore connu une augmentation de ses effectifs de 62 000 personnes en 2023 (derniers chiffres INSEE) : « les prévisions de croissance d’effectifs d’agents publics et de contractuels gagneraient à être précisées, et comparées aux tendances historiques en la matière ».
De plus, la modération salariale des rémunérations de fonctionnaires et l’évolution croissante de la part des primes jusqu’en 2037 méritent aussi d’être questionnées. Il paraît peu réaliste que de telles hypothèses ne soient pas remises en cause par des revendications salariales au sein de la fonction publique d’ici cette date. Le CSR considère donc que le niveau des dépenses des régimes de la fonction publique pourrait bien être sous-estimé.
Au sein du secteur privé, c’est la part des dépenses des régimes complémentaires dans le PIB, en légère décroissance (de 4,0 % en 2025 à 3,8 % en 2070), qui pose question. Cela repose là encore sur une hypothèse : que la valeur de service du point à l’Agirc-Arrco évolue conformément aux paramètres fixés par le dernier ANI à savoir une évolution comme le salaire moyen minoré de 1,16 %. Faute de visibilité sur les paramètres futurs de l’Agirc-Arrco, le COR prolonge les règles actuelles sur 45 ans « de manière peu réaliste ». Notons déjà que cette sous-indexation peut faire l’objet d’un aménagement en accord avec les partenaires sociaux (ce qui a été le cas en 2024) et comme le souligne le CSR, « il semble peu réaliste de retenir une hypothèse sous-indexant les pensions pendant 45 ans qui se traduirait, pour le régime, par l’accumulation de réserves massives ». Le CSR considère donc que le niveau des dépenses de l’Agirc-Arrco est peu réaliste et sous-estimé dans les projections du COR.
« Le CSR estime donc que les hypothèses de projection de certains régimes font apparaître un aléa haussier sur l’évolution des dépenses projetées des retraites, si la modération salariale dans la fonction publique est moindre qu’anticipé, ou si les partenaires sociaux adoptent une trajectoire de revalorisation des pensions plus favorable à l’Agirc-Arrco. »
2/ Augmentation de la dette sociale
Les chiffres sont sans appel : le solde du système de retraite est déficitaire de -0,5 point de PIB par an en moyenne sur les 25 prochaines années. Entre 2025 et 2030, le solde estimé est compris entre -0,1 et -0,2 point de PIB, et se dégrade continûment entre 2030 et 2050, passant à -1,1 point de PIB dans le scénario de référence.
Cela étant dit, le comité rappelle quelques évidences :
Le CSR ne peut pas proposer de hausse de cotisation d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire, car le décret du 20 juin 2014 qui détermine ses missions fixe un plafond à 28 % de la rémunération d’un non-cadre sur le taux de cotisation qu’il ne faut pas dépasser, plafond qui est déjà atteint.
Par ailleurs, ce levier a un effet récessif sur l’économie, faut-il le rappeler. Une hausse de cotisation salariale pèse sur le salaire net à court terme et réduit la demande des ménages, tandis qu’une hausse de cotisation patronale augmente le coût du travail, ce qui réduit l’investissement et l’emploi ou pèse sur le salaire. Dernier point, et non des moindres, les cotisations sur les salaires sont élevées en France en comparaison européenne.
Le CSR rappelle aussi que des ressources autres que des cotisations ont été apportées au système de retraite en 2025 pour 1,2 Md€ (régime général). La Cnav a bénéficié de la moitié des gains liés à la réforme des allègements généraux de cotisations (à hauteur de +0,8 Md€) et de la hausse du taux de contribution sur les attributions gratuites d’actions et de stock-options (+0,4 Md€).
Pour conclure, le CSR rappelle qu’en l’absence de mesure correctrice, la dette sociale liée à la retraite constituée entre 2025 et 2050 représenterait 12,5 points de PIB, soit 375 Mds €2025. Ce montant est à mettre en comparaison des reprises de déficits passés déjà réalisées à ce jour par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), et qui représentent de l’ordre de 5 % du PIB.
« La soutenabilité financière du régime général devra donc constituer dans l’avenir la priorité du pilotage du système de retraite ».
3/ Le CSR ne recommande pas de revenir sur l’âge
Les chiffres sont désormais bien connus : les comparaisons internationales montrent que, si le taux d’emploi des 55-59 ans en France se situe dorénavant dans la moyenne des pays de l’OCDE, les résultats demeurent inférieurs pour les 60-64 ans. Et le CSR rappelle que si le taux d’emploi des seniors s’est fortement amélioré depuis 2000, cette amélioration s’avère, en premier lieu, le résultat des réformes des retraites mises en œuvre depuis une trentaine d’années sur les paramètres d’âge et de durée.
La réforme de 2023 a à nouveau reporté l’âge légal et la durée de cotisation. Ajouté au décalage de l’entrée dans la vie active (augmentation de la durée des études), le COR projette que l’âge moyen de départ à la retraite se stabiliserait autour de 64,7 ans à partir des générations nées dans les années 1975. Mais plusieurs dispositifs viennent modifier cet âge projeté de départ en retraite. Comme les précédentes réformes, derrière l’objectif général de recul de l’âge de la retraite, de nouvelles possibilités de départs anticipés ont été ouvertes, ce qui explique qu’encore près de 40 % des assurés partent avant l’âge légal.
D’abord, ceux dont l’espérance de vie est la plus faible, les personnes en situation d’inaptitude au travail ou d’invalidité, ont bénéficié d’un maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans dans le cadre de la réforme des retraites de 2023.
Mais la dernière réforme des retraites s’est particulièrement focalisée sur les carrières longues. Le CSR rappelle que, contrairement à une idée reçue, associant trop rapidement carrières longues et pénibilité, les personnes liquidant actuellement au titre des retraites anticipées pour carrières longues (RACL) ne présentent pas une moindre espérance de vie ni un plus mauvais état de santé, et cela ne concerne pas que les personnes les moins qualifiées. C’est particulièrement vrai pour les assurés qui ont commencé à travailler à 18, 19 ou 20 ans (et non pas à 15, 16 ou 17 ans) et qui ont bénéficié d’aménagements dans le cadre de la réforme 2023.
Autre dispositif mis en avant durant la réforme et relancé depuis : la retraite progressive. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 visant à favoriser le maintien en emploi ou l’accès à l’emploi des seniors doit permettre l’abaissement de 62 à 60 ans pour l’éligibilité à la retraite progressive. Ce genre de dispositif a un impact positif sur le taux d’emploi, mais beaucoup moins sur le nombre d’heures travaillées.
Considérant que les mesures d’âge et de durée d’assurance prévues par la réforme de 2023 sont encore en cours de montée en charge, le CSR estime qu’il n’est pas possible ni souhaitable d’ajouter d’autres mesures structurelles dès maintenant même si des mesures devront être décidées avant 2030. Des mesures nouvelles d’aménagement ne devraient pas conduire à diminuer le taux d’emploi des personnes de plus de 60 ans. Disant cela, le CSR vise les mesures issues des discussions des partenaires sociaux (conclave) si elles étaient reprises par le Gouvernement.
Le CSR suggère même que le dispositif carrière longue (au regard notamment de son caractère non ciblé sur des assurés à l’état de santé dégradé) pourrait contribuer au retour à l’équilibre à l’horizon 2030, au moins pour les personnes ayant commencé à travailler à 21 ans, voire à 20 ans.
Le CSR recommande de ne pas revenir sur les cibles d’âge et de durée de la réforme de 2023. Au-delà de sa contribution à l’équilibre financier du système de retraite, la hausse des taux d’emploi et de l’âge effectif de fin d’activité induit des effets positifs pour l’économie dans son ensemble.
4/ Le CSR recommande avec prudence une désindexation
Le levier de la sous-indexation des pensions a été discuté par les partenaires sociaux au sein de la délégation paritaire permanente (conclave). La piste envisagée consistait en une sous-indexation de 0,8 point en 2026 puis de 0,4 point par an entre 2027 et 2030, soit une sous-indexation cumulée de 2,4 points. Par ailleurs, on rappellera qu’une sous-indexation des pensions versées par l’Agirc-Arrco est prévue par les partenaires sociaux jusqu’en 2027.
Une sous-indexation cumulée des pensions versées par les régimes de base de l’ordre de 2 % ou un peu supérieure au cours des cinq prochaines années permettrait de ramener le système à l’équilibre en 2030, nous dit le CSR. L’effet récessif d’une telle mesure devrait rester limité dans un contexte de forte épargne des retraités.
Le principal argument en faveur de cette mesure est le niveau de vie des retraités, élevé en comparaison européenne. Après avoir été légèrement supérieur à 100 % dans la décennie 2010, le niveau de vie des retraités représente 97 % de celui de l’ensemble de la population en 2022. Si l’Italie et l’Espagne présentent des taux équivalents ou un peu supérieurs à la France, plusieurs des pays suivis par le COR ont des taux compris entre 80 et 90 %.
L’épargne des retraités a augmenté depuis 2019, davantage que celle des actifs. En outre, les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que les actifs ou que l’ensemble de la population et ont ainsi moins souvent à payer un loyer. En 2022, le niveau de vie des retraités avec loyers imputés serait alors de 4,8 % plus élevé que celui de l’ensemble de la population, soit un niveau très proche de celui des actifs.
Le CSR considère donc que des marges de manœuvre existent pour mobiliser le levier de la sous-indexation dans les régimes de base afin d’assurer le retour à l’équilibre du système de retraite d’ici 2030 :
Le montant des pensions versées par les régimes de base atteint près de 300 Md€ en 2025, soit plus de 340 Md€ prévus en 2030. Une sous-indexation de 0,1 point représente un gain pour les régimes de 300 M€ en 2025 et de 340 M€ en 2030. Pour neutraliser le déficit de 6,6 Md€ en 2030, il faudrait sous-indexer les pensions d’un montant cumulé de 1,9 point. Toutefois, si ce montant permet d’atteindre l’équilibre du système de retraite en 2030, il ne tient pas compte d’un effet retour sur l’impôt sur le revenu et la CSG : de moindres pensions conduisent en effet à de moindres prélèvements. Si on se place sur le plan des finances publiques, pour atteindre un rendement de 6,6 Md€, le montant cumulé de la sous-indexation devrait donc être un peu plus élevé.
Mais le CSR appelle à la prudence :
D’une part, en raison d’un effet récessif sur l’économie. Cet effet pourrait être limité compte tenu de leur taux d’épargne. D’autre part, un système de retraite par répartition repose sur une promesse implicite entre les cotisants et les retraités de maintien d’un « niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités ». Le CSR appelle à donner de la visibilité aux retraités et aux cotisants sur ce niveau de vie satisfaisant. Cette question est essentielle : les retraités peuvent avoir le sentiment à juste titre d’être piégés par les pouvoirs publics qui ne leur garantissent pas leur pouvoir d’achat. La responsabilité du gouvernement devrait plutôt être de tenir un discours de vérité en incitant à travailler plus longtemps pour maintenir un taux de remplacement plus élevé. En Suède, l’indexation des retraites reste « accrochée » à la croissance avec une indexation basée sur la croissance du PIB moins 1,6 point. Un moyen efficace de créer un pacte entre actifs et retraités sur le partage de la croissance.
Sur le mode de désindexation, le CSR se penche sur des mesures spécifiquement en prélèvements obligatoires qui pourraient toucher les retraités (ex. suppression de l’abattement de 10%) et rappelle que cette mesure ne rapporterait pas directement au système de retraite, mais au budget de l’État. Une mesure affectant l’indexation selon le taux de CSG appliqué (définis selon le revenu fiscal de référence du foyer) doit être utilisée avec la plus extrême prudence, précise le CSR, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige, en raison du caractère contributif des régimes d'assurance vieillesse et de l’inégalité de traitement entre retraités, qu’une telle différenciation soit d’une ampleur limitée (le Conseil a validé une dizaine d’euros d’écart après lissage) et exceptionnelle (après avoir validé une première revalorisation différenciée votée en 2014, le Conseil en a de nouveau validé une en 2020, soit 5 ans après).
« Le CSR considère donc que les marges d’équilibrage financier par la sous-indexation des pensions versées par les régimes de base existent, mais doivent être mobilisées avec prudence. »
Conclusion
Au vu de la trajectoire financièrement dégradée du système de retraite, en particulier de la CNRACL et du régime général, le CSR considère qu’il relève de son mandat de formuler une recommandation pour ramener le système à l’équilibre. Il ne recommande pas de revenir sur les cibles d’âge et de durée de la réforme de 2023. Au-delà de sa contribution à l’équilibre financier du système de retraite, la hausse des taux d’emploi et de l’âge effectif de fin d’activité induit des effets positifs pour l’économie dans son ensemble, nous dit le comité. Une sous indexation (et non un gel) étalée jusqu’en 2030 pour un total cumulé de 2% serait de nature à ramener le système à l’équilibre. Mais le comité suggère aussi que le dispositif carrière longue pourrait contribuer au retour à l’équilibre à l’horizon 2030, au moins pour les personnes ayant commencé à travailler à 21 ans, voire à 20 ans.
[1] Les objectifs du système ont été précisés par la loi du 20 janvier 2014. Ils sont de quatre ordres :
le versement de pensions en rapport avec les revenus tirés de l’activité, un traitement équitable des assurés au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent ;
la solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les hommes et les femmes, la prise en compte des périodes de privation involontaire d’emploi, la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités ;
la pérennité financière assurée par une répartition équitable des contributions entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital.