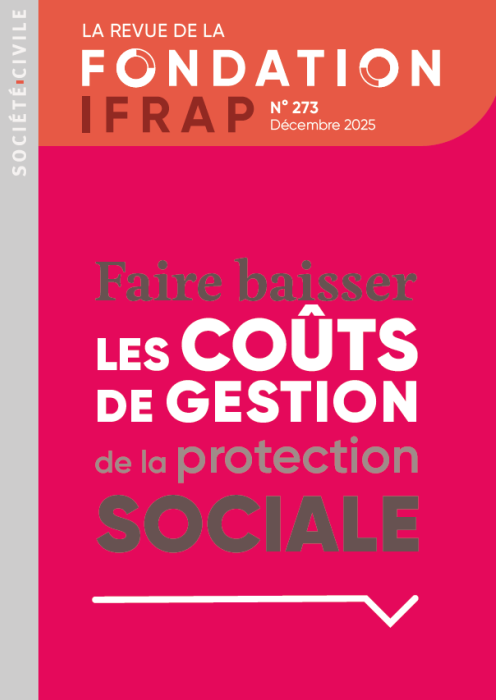Négociation collective d’entreprise, les vrais enjeux

Voici un mois, Manuel Valls a confié à une commission menée par Jean-Denis Combrexelle la mission de remettre en septembre prochain des propositions en vue d’« élargir la place de l’accord collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales » (voir ci-dessous extraits de la lettre de mission). Il s’agit de « faire une plus grande place à la négociation collective et en particulier à la négociation d’entreprise, pour une meilleure adaptabilité des normes aux besoins des entreprises ainsi qu’aux aspirations des salariés ». Le Premier ministre fait allusion au projet de loi dit Rebsamen sur la réforme du dialogue social, dont il reconnaît implicitement l’insuffisance, en affirmant qu’il « faudra aller plus loin dans la réforme » pour « donner plus de place au dialogue social de terrain ». Bonnes intentions certes, mais de celles qui ne feront rien de mieux que paver l’enfer si simultanément la réforme n’est pas accompagnée de bien d’autres, que le gouvernement paraît malheureusement écarter d’emblée.
Extraits de la lettre envoyée le 1er avril par le Premier ministre à Jean-Denis Combrexelle
[...]
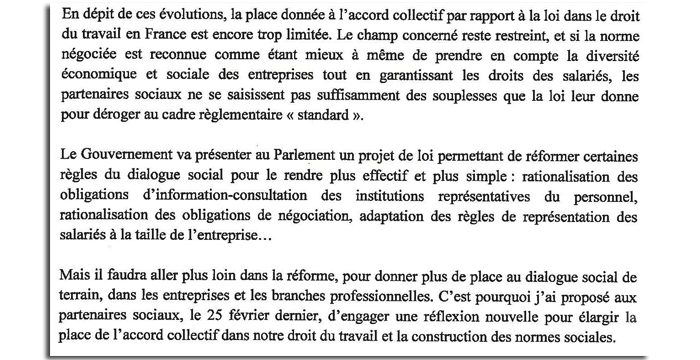
[...]
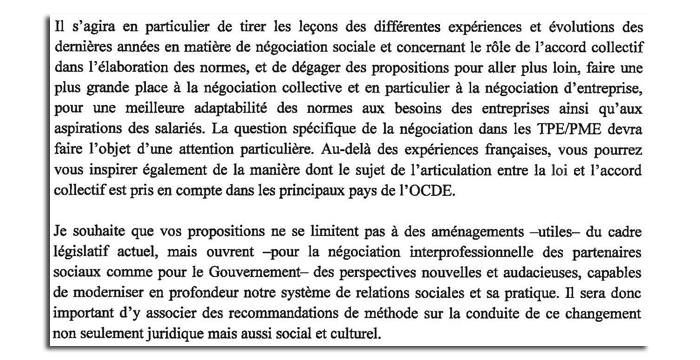
[...]
De quoi s’agit-il au juste ?
Donner plus de place à la négociation collective, qu’est-ce que cela signifie ? Une précision apportée par l’entourage du Premier ministre nous éclaire : la « démarche ne vise pas à supprimer des pans du Code du travail pour les renvoyer aux entreprises, mais à permettre d’y déroger et de s’y adapter ». Cela a quelque chose à voir avec l’inversion de la hiérarchie des normes, formule mise à la mode par certains pour signifier leur désir de voir les accords d’entreprise primer sur la loi. Il semble bien que le gouvernement, comme les partenaires sociaux d’ailleurs, ait été marqué par l’échec de la disposition sur le maintien dans l’emploi, héritée de l’accord national interprofessionnel de janvier 2013 (voir notre note précédente). Cette disposition, censée permettre des accords majoritaires aboutissant à modifier durée du travail et rémunérations, n’a effectivement pas été appliquée par les entreprises en raison de la rigidité de ses conditions, et l’idée d’un ministre comme Emmanuel Macron est au contraire d’en élargir l’application, en particulier sans la restreindre aux entreprises en difficulté.
En réalité, la formule d’inversion de la hiérarchie des normes est assez creuse. La Constitution dans son article 34 impose que ce soit la loi elle-même (au sens strict des dispositions votées par l’Assemblée nationale) qui « détermine les principes fondamentaux » du droit du travail. La commission Combrexelle aura donc pour tâche de déterminer les dispositions du code du travail qui pourraient ne pas être d’ordre public (à l’heure actuelle elles le sont pratiquement toutes), afin que l’Assemblée nationale modifie la loi en conséquence dans chaque cas en autorisant les dérogations. Mais ce faisant, la commission devra se tenir hors des limites des « principes fondamentaux »… dont nul ne connaît le contenu, ni ne le connaîtra aussi longtemps que le Conseil constitutionnel ne se sera pas prononcé. Comme la France se signale par une explosion des textes de niveau législatif en droit du travail (pour ne parler que de ce niveau), la tâche va se révéler singulièrement ardue. Par exemple, élargir la disposition mentionnée ci-dessus sur le maintien dans l’emploi pourrait vider de sa substance les 35 heures, et porter par ailleurs atteinte à la règle de l’intangibilité du contrat de travail individuel[1], dont on peut se poser la question de savoir s’il s’agit d’un principe fondamental.
En tout état de cause, la démarche n’est pas susceptible de simplifier le code du travail, bien au contraire
Malgré ses 3.500 pages, le code du travail continue, chaque mois, à s’enrichir de quelques dizaines de nouvelles pages : la future loi Macron ne manquera pas de le faire, de même que la future loi Rebsamen[2]. Mais comme, à en croire le Premier ministre, il est exclu de simplifier le code en supprimant une partie de la règlementation[3], le mécanisme est donc par lui-même source de complications puisqu’il maintient la loi dans toutes ses dispositions, lesquelles continueront à s’appliquer sauf dérogations expressément consenties par accord majoritaire. On peut en comprendre l’intérêt pour des grandes entreprises, pourvues de directions de ressources humaines capables de négocier avec les émanations des puissantes centrales syndicales. Mais pour les petites entreprises, la mise en œuvre du mécanisme supposerait en premier lieu que leur chef connaisse le code du travail pour être capable d’en discuter les termes (non, on ne plaisante pas, et il n’y a pas de DRH avant 75 salariés environ) et de savoir de quelle latitude il dispose pour y déroger et comment le faire. Ce qui est parfaitement illusoire.
Le cadre des accords collectifs est-il vraiment adapté ?
De nouveau se pose la question du dialogue social dans les petites entreprises, lorsqu’elles ne disposent pas d’institutions représentatives du personnel capables de signer des accords majoritaires. Cela n’a pas échappé d’ailleurs au gouvernement qui souligne que « la question spécifique de la négociation dans les TPE/PME devra faire l’objet d’une attention particulière ». Néanmoins, un récent rapport de la Commission de Bruxelles nous apprend que, si la France se signale par une place de 27ème – derrière l’Estonie - sur les 28 pays membres de l’UE pour le taux de syndicalisation (7,7%), sa place est bien meilleure pour la représentation collective : 55% des salariés des entreprises de 10 salariés et plus sont représentés. Ce qui serait de nature à relativiser les difficultés du dialogue social.
D’une façon générale, se pose le problème de la place des syndicats dans l’entreprise, car plus d’accords collectifs signifie plus de pouvoir pour les syndicats. Et là le bât blesse sérieusement, en raison du peu de représentativité des syndicats. De récents sondages sur l’utilité des syndicats ont de plus démontré un état de crise de crédibilité prononcé, au point que 68% des sondés trouvent que les syndicats ne sont pas représentatifs et 54% qu’ils ne sont pas « utiles » (voir encadré).
Sur RTL : le débat entre Jean-Pierre Mercier et Karine Charbonnier et les réactions des auditeurs. La semaine dernière, RTL invitait Jean-Pierre Mercier, syndicaliste CGT présent chez PSA, et Karine Charbonnier, dirigeante de Beck Industries, une ETI d’Armentières, à débattre sur l’utilité des syndicats. Débat tournant en réalité autour de la façon dont les syndicats conçoivent leur intervention, car évidemment pour personne il n’est question de les « éradiquer ». Karine Charbonnier faisait état d’un divorce certain entre les aspirations des salariés et la présence syndicale. Elle insistait sur la frustration des salariés qui ne peuvent se faire entendre lors des élections en raison du monopole syndical des candidatures au premier tour, ainsi que sur les pressions qu’ils subissent. D’autre part, elle relevait les déviances entraînées par le mandat syndical : c’est le délégué syndical qui est le personnage le plus important et signe les accords d’entreprise. Or il n’est pas directement issu de la représentation salariale, mais est nommé et révoqué par les syndicats dont il répercute les instructions dans un mouvement « top down » qui ne tient pas compte des aspirations des salariés de l’entreprise et est seulement marqué d’idéologie. Les auditeurs à qui la chaîne donnait ensuite la parole, confirmaient pleinement ce point de vue. L’un, ancien contremaître dans une usine, s’est dit « sidéré », « écoeuré » a-t-il corrigé, par l’attitude des syndicats, systématiquement dans l’opposition (allant jusqu’à exercer de telles pressions sur les salariés qu’ils leur interdisent en fait de faire des heures supplémentaires) et par le mépris de règles comme la limitation des heures de délégation. L’autre a abondé dans le sens de la non représentativité des syndicats, en raison d’une culture venant des entreprises publiques, et du primat d’une idéologie anti-entrepreneuriale. |
En fin de compte, la démarche de la mission ne peut pas aboutir sans faire de véritables réformes
Tout ce que l’on peut qualifier de mal français provient d’un système qui mêle jacobinisme centralisateur, compétence hypertrophiée de la loi et culture idéologique de l’affrontement chez plusieurs des principaux syndicats - lesquels ne font qu’ajouter à la tendance de tout régir par la loi en raison de leur refus d’exercer des responsabilités au niveau de l’entreprise.
Pour en revenir une fois de plus à une comparaison avec notre voisin allemand, on relève évidemment d’abord l’attitude pragmatique et responsable des syndicats, dont les revendications, qui peuvent se manifester violemment, ne se placent jamais dans un contexte d’affrontement destructeur. C’est un point suffisamment connu pour qu’on n’y insiste pas. Ce qui l’est moins, c’est que les syndicats, du moins dans les petites ou moyennes entreprises, ne sont pas présents ou n’y exercent aucun rôle prépondérant. Ils ne disposent notamment d’aucune priorité de candidature au Betriebsrat (conseil d’établissement).
Par ailleurs, la hiérarchie des normes est toute différente en Allemagne, puisque la loi n’existe simplement pas, sauf sur certains sujets limités d’ordre public. De sorte que les normes sont quasi-exclusivement les accords collectifs de branche, auxquels les entreprises peuvent déroger, en principe dans un sens favorable au salarié. Mais les accords historiques de Pforzheim en 2004 ont permis aux entreprises de fixer salaires et durée de travail : le pas décisif vers la flexibilité. Il n’existe d’ailleurs pas de durée légale du travail en Allemagne. Pour compléter le tableau, on signale que les accords majoritaires s’imposent au salarié, qui sera automatiquement licencié s’il en refuse l’application en ce qui le concerne (procédure de l’Änderungskündigung).
Les propositions de la Fondation iFRAP
On le voit, les différences entre les droits du travail sont nombreuses et très complexes, mais la comparaison permet quand même de se faire une idée des réformes qui devraient accompagner le développement de la négociation collective souhaité par le Premier ministre, et que l’on peut ainsi résumer :
- Supprimer le monopole syndical de présentation au 1er tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise (IRP, instance representative du personnel) : Si la commission ne peut pas grand-chose pour modifier la culture et l’attitude d’affrontement idéologique de certains syndicats, que même la CFDT qualifie de « rétrogrades », il faut privilégier, en l’état actuel, toute réforme qui permettrait, pour la négociation des accords collectifs, d’assurer la représentativité des salariés en dehors des syndicats si ces salariés le désirent : c’est pourquoi il est très important de supprimer le monopole des syndicats au premier tour des élections, et de revoir le rôle du délégué syndical ;
- Limiter les dispositions strictement législatives aux « principes fondamentaux » du droit du travail : Plutôt que de seulement permettre aux accords collectifs de déroger aux dispositions d’une loi pléthorique, il faudrait supprimer de la loi ce qui ne ressort pas des « principes fondamentaux » du droit du travail au sens constitutionnel de l’expression. On a dit plus haut que malheureusement le gouvernement l’exclut en ce qui concerne la mission donnée à Jean-Denis Combrexelle, comme il a déjà exclu de revenir sur les 35 heures. On rappelle à ce sujet que le Conseil constitutionnel s’est opposé, au visa de l’article 34 de la Constitution, à toute délégation générale donnée par la loi au gouvernement pour réglementer par voie de décret les heures supplémentaires. Et si, comme en Allemagne, la durée du travail était carrément sortie de la loi ? Ce serait une réforme considérable évidemment, mais il faut sortir de ce cadre toujours plus hypertrophié de la loi, et pas seulement permettre d’y déroger. Sans quoi on ne peut vraiment pas être optimiste sur les avancées du droit du travail ;
- Sanctionner par un licenciement automatique le refus individuel du salarié de se voir appliquer les accords majoritaires : La commission ne devra pas non plus oublier d’assurer la primauté de l’accord majoritaire sur le contrat individuel, en faisant en sorte que le refus du salarié de s’y soumettre puisse être réputé cause réelle et sérieuse de licenciement. L’Assemblée nationale s’y est malheureusement refusée lorsqu’elle a voté la loi mettant en œuvre le maintien dans l’emploi. Un autre progrès à réaliser.
[1] Le droit français est extrêmement protecteur de l’individu, et la modification de son contrat ne peut pas lui être imposée, l’accord majoritaire n’étant pas considéré comme une justification suffisante de licenciement en cas de refus du salarié. Ceci est une des causes de l’échec de la disposition sur le maintien dans l’emploi.
[2] Cela dit, nous n’avons pas manqué déjà de signaler que ce calcul du nombre de pages n’avait pas grand sens dans la mesure où l’on comptabilisait ainsi les pages consacrées à l’exposé de la jurisprudence ainsi qu’à nombre de règlementations sectorielles.
[3] Rappelons-nous que Michel Sapin répondit à ceux qui trouvaient le Code du travail trop long qu’il suffisait de l’imprimer en « petits caractères » !