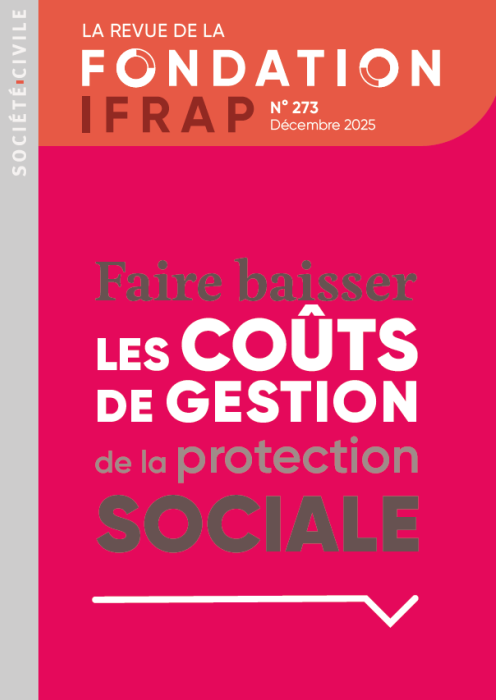Les accords de maintien de l'emploi, les dures leçons d'un échec prévisible

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, entré en vigueur, avec quelques modifications, avec la loi du 14 juin 2013, a maintenant un an et demi d'existence. Son article 18, transcrit dans le Code du travail sous les articles 1525-1 à 1525-7, introduit la possibilité pour les employeurs et les salariés de signer des accords collectifs de maintien de l'emploi. Cette disposition, qui constituait avec celle concernant la modification des procédures de licenciement collectif la réforme essentielle qu'attendait le patronat, se révèle être un échec quasi complet. Pourquoi ? Les raisons en font un cas d'école de la production législative française aussi impossible à contenir qu'inapplicable, ainsi que de l'échec propre du dialogue social au niveau de la nation. Une question qui est d'actualité brûlante à deux titres : les négociations en cours entre partenaires sociaux concernant seuils sociaux et représentation des salariés, et la discussion au Parlement sur les améliorations que la future loi Macron est censée apporter à la procédure de licenciement, cet autre sujet essentiel traité par l'ANI de 2013.
Le but recherché des accords de maintien de l'emploi était de faciliter la flexibilité des conditions de travail, lorsque celle-ci, en cas de difficultés rencontrées par les entreprises, se révélait nécessaire pour éviter des plans sociaux. Ainsi les entreprises pourraient-elles, sous condition de signature d'un accord collectif et de celui de la majorité syndicale, diminuer les rémunérations ou modifier le temps de travail ou encore diminuer certains avantages accordés aux salariés.
Mais la peur que les patrons utilisent ces accords pour exercer un « chantage à l'emploi » ont accompagné cette réforme d'une telle succession de conditions et garde-fou que quasiment aucune application n'en a été faite depuis un an et demi, voire, pire, que dans la seule grande entreprise qui en ait fait usage, le résultat a été si négatif que les syndicats se sont juré qu'on ne les y reprendrait pas deux fois.
L'expérience de Mahle Behr
Une explication d'abord sur l'expérience vécue au sein de Mahle Behr, l'entreprise alsacienne, filiale d'une maison mère allemande, où un accord de maintien dans l'emploi fut conclu en 2013 [1]. Plus de mille salariés, cinq syndicats représentés, après un référendum favorable un accord intervient qui stipule la suppression de cinq jours de RTT et un gel des salaires pendant deux ans, en échange de quoi l'entreprise s'engage à investir, ne supprimer aucun emploi pendant deux ans et transférer deux contrats en provenance d'autres sociétés du groupe. Mais la loi prévoit que chaque salarié individuellement peut refuser l'accord, auquel cas il doit être licencié, sans toutefois bénéficier des avantages d'un plan social. Désagréable surprise, 162 salariés, au lieu des 50 prévus, refusent l'accord, et l'entreprise n'a embauché que 57 salariés pour remplacer les partants, tout en faisant faire de nombreuses heures supplémentaires et avec un taux important d'intérimaires dans les effectifs. Alors que l'accord avait pour raison d'être d'éviter 102 licenciements, l'affaire se termine – pour l'instant – par une réduction de personnel supérieure. Les salariés ont l'impression de s'être fait avoir. D'autant plus, comble de malchance, que l'entreprise vient de manquer un gros contrat qui lui aurait donné du travail pendant sept ans. Malgré le démenti et les explications de la direction, ils craignent de ne pouvoir éviter un plan social et ne comprennent pas qu'il s'agit des aléas de la vie des affaires.
Trois pages de plus, inutiles et plutôt malfaisantes, du Code du travail
Pourquoi ? D'abord parce que la loi limite l'accès à l'accord de maintien de l'emploi aux situations dans lesquelles les entreprises rencontrent des difficultés à la fois « graves » et « de nature conjoncturelle ». Des notions trop vagues pour servir de critère certain, et en particulier la cause conjoncturelle est presque toujours mélangée de cause structurelle. Les entreprises craignent donc d'être en tort lorsqu'elles font appel à la disposition.
Seconde raison de non-recours, la panoplie considérable de conditions et garde-fou exigée par la loi. Outre la limitation qui vient d'être mentionnée, citons les conditions suivantes : la durée doit être au maximum de deux ans (pourquoi ?), recours par le comité d'entreprise à un expert comptable aux frais de l'entreprise, les efforts demandés ne peuvent pas concerner les salariés rémunérés en dessous de 1,2% du Smic, efforts obligatoires des dirigeants et actionnaires, interdiction de licenciements pour cause économique pendant la durée de l'accord, détermination par avance des conséquences de l'amélioration des résultats, clause pénale obligatoire ainsi que compétence du juge qui peut suspendre d'autorité l'accord pour le cas où l'employeur ne remplirait pas ses engagements, procédure minutieuse pour recueillir l'accord des salariés…
À noter enfin le « clou » de l'affaire, lorsque des salariés refusent l'accord à titre individuel, ils doivent être licenciés sous la procédure de licenciement économique individuel, mais le gouvernement a refusé d'inclure la phrase prévue par les négociateurs de l'ANI, à savoir que la cause réelle et sérieuse du licenciement - pourtant exigé par la loi elle-même – serait réputée acquise. De ce fait, malgré toute la procédure de l'accord, la sécurité ne serait pas acquise pour l'employeur puisqu'un tribunal pourrait toujours annuler les licenciements intervenus !! Ce qui supprime tout l'intérêt de la disposition, qui avait justement pour but de rendre possible et sécuriser l'accord collectif…
Dans de telles conditions il n'est pas étonnant que la loi ne reçoive pas d'application. Et le Code du travail s'est néanmoins accru de trois pages inutiles, et plutôt malfaisantes dans la mesure où, comme on le voit dans le cas de l'entreprise Mahle Behr, leur application ferait naître illusions et déceptions chez les salariés.
Tirer les conclusions de l'échec
Patronat, syndicats et gouvernement sont à blâmer dans cet échec si prévisible. Comment se fait-il en effet que les négociateurs aient pu se mettre d'accord sur une disposition reposant sur de telles aberrations économiques ?
Le patronat est le premier à savoir qu'aucune entreprise, déjà en difficulté par hypothèse, ne peut s'engager à limiter à deux ans les efforts demandés, à ne pas licencier pendant ces deux ans, le cas échéant à remplacer les salariés refusant l'accord, à déterminer par avance les conséquences d'une amélioration, à ne faire porter les accords que sur les salariés rémunérés à plus de 1,2 Smic, le tout sous la menace d'une clause pénale automatique et à la merci des décisions discrétionnaires d'un tribunal qui est le dernier à pouvoir juger de la situation. De tels engagements seraient irresponsables. Pour le patronat, signer cette disposition de l'ANI de 2013 ne serait à la limite pas grave si pour l'obtenir il n'avait pas dû en contrepartie, et suivant la règle habituelle du donnant-donnant dans les négociations entre partenaires sociaux, consentir aux diverses et lourdes concessions accordées dans ce même ANI. Cela rappelle l'affaire empoisonnante des contreparties impossibles à donner en échange du CICE. Le patronat a ici lâché la proie pour l'ombre.
On ne peut aussi que blâmer les exigences perpétuelles des syndicats qui contraignent le patronat à bâtir de véritables usines à gaz où tout doit être prévu, ce qui rend inapplicable tant de dispositions du Code du travail et condamne ce dernier à grossir démesurément et à un rythme qui ne diminue pas. Cela en raison de la sempiternelle présomption de mauvaise foi pesant sur les entreprises que l'on veut empêcher de pratiquer un « chantage ».
Sur le gouvernement enfin pèse la plus forte responsabilité. D'abord en fixant les bornes de la négociation et en forçant le patronat à rentrer dans le piège, mais surtout au cas présent en refusant de transcrire la précision analysée ci-dessus concernant la cause réelle et sérieuse des licenciements faisant suite aux refus individuels de se plier aux conditions de l'accord de maintien de l'emploi signé. Or on sait bien que la compétence des tribunaux pour déclarer sans cause réelle et sérieuse des licenciements est le poison essentiel de cette procédure. Le gouvernement ne veut pas soulever ce tabou. Mais il avait ici quand même l'occasion d'écarter le recours au juge sur ce point précis, dans la mesure où c'est la loi elle-même qui contraint à licencier les salariés opposés à l'accord. On ne voit pas ici le risque d'inconstitutionnalité, mais plutôt l'effet d'une lâcheté trop habituelle.
Au final, une disposition aussi importante que celle-ci, qui aurait permis d'introduire une flexibilité présente dans la législation des pays qui nous entourent, est nulle et non avenue. Le seul espoir, mais est-il encore vivant ?, consiste dans la déclaration du ministre de l'économie pensant à élargir le domaine d'application de l'article en question. Mais en laissant subsister les conditions qui le rendent en fait inapplicable ?
Enfin, n'entend-on pas sonner le glas du type de dialogue social national sur lequel tentent de se reposer les gouvernements depuis quelques années ? Centrales syndicales et patronales affaiblies et non, ou peu représentatives, négociations réduites à des manifestations de postures, sujets imposés par le gouvernement et évitant soigneusement ceux qui fâchent ou ne seraient simplement pas de la compétence des partenaires sociaux, culture du donnant-donnant à l'heure où des réformes de base s'imposent et ne relèvent pas du compromis, ce n'est pas par des négociations entre ces partenaires sociaux que les choses peuvent avancer. À propos de la négociation en cours actuellement sur les institutions représentatives du personnel, un adhérent du Medef s'exaspérait dans les colonnes de l'Opinion du 14 janvier : « À l'origine, l'idée était de simplifier les passages de seuils pour permettre le développement des entreprises, pour relancer l'emploi. Et l'on se retrouve avec les sempiternelles et stériles négociations sociales du donnant-donnant, pour savoir comment les syndicats pourraient être représentés dans les sociétés. On n'en peut plus de ces vieilles lunes ! » Constat amer sur l'inefficacité du dialogue social. Ce n'est pas étonnant, et c'est à l'État de prendre les choses en main à l'heure des grandes réformes. Quant au patronat, il devrait rester ferme sur ses positions et ne pas se laisser entraîner, au prétexte de prétendus compromis indispensables, à signer des accords qu'il désapprouve fondamentalement.
[1] Cinq accords de maintien de l'emploi en tout et pour tout semblent avoir été recensés depuis un an et demi. Quatre d'entre eux concernent des PME de quelques dizaines de salariés, et le bilan n'est pas encore établi. Il s'agit de Stor Solutions à La Réunion, Walor à Légé, Marchal Technologies à Plaisir et Aerotech à Chateaubernard.