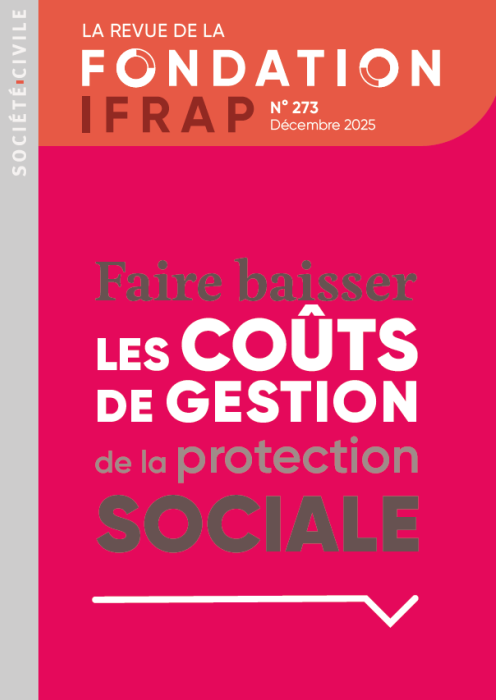Les effets pervers de la défiscalisation des heures supplémentaires

La politique de défiscalisation des heures supplémentaires, introduite initialement pour stimuler le pouvoir d’achat des salariés et inciter au travail additionnel, engendre, dans certaines situations, des effets pervers. Lorsqu’une entreprise souhaite faire évoluer ses salariés d’un statut horaire (basé sur le décompte des heures) vers un statut au forfait jour (basé sur un nombre annuel de jours travaillés, souvent associé aux cadres et aux postes à plus forte autonomie), des effets de bord apparaissent. Ils créent des surcoûts significatifs, non seulement pour l’entreprise, mais également pour les salariés eux-mêmes.
Cette situation est issue d’une volonté initiale de soutien au travail. Pourtant, elle pénalise aujourd’hui les employeurs dynamiques cherchant à accompagner la montée en compétence et en responsabilité des travailleurs. C’est un cas typique qui touche de nombreuses PME.
La défiscalisation des heures supplémentaires
Depuis plusieurs années, l’État français a mis en place un mécanisme d’exonération fiscale et sociale pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés. Ce dispositif répond à un double objectif :
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés en rendant ces heures supplémentaires non imposables à l’impôt sur le revenu et partiellement exonérées de charges sociales.
Alléger le coût du travail additionnel pour les entreprises, en limitant les charges patronales associées, afin de favoriser la flexibilité et la compétitivité.
Ainsi, un salarié payé sur la base de 35 heures peut percevoir une rémunération correspondant à 39 heures, les 4 heures supplémentaires bénéficiant d’un traitement fiscal et social favorable.
D’abord instauré en 2007 par la loi TEPA sous Nicolas Sarkozy, ce mécanisme est supprimé par François Hollande, puis réintroduit en 2019 par Emmanuel Macron. Les heures supplémentaires sont ainsi exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à 7 500 € par an, et bénéficient d’allègements de cotisations sociales.
Les statuts horaires et le forfait jour
En France, le droit du travail distingue les salariés soumis à un décompte horaire et ceux au forfait jour. Pour les premiers, le temps de travail est suivi (badgeage, pointage, relevés) et rémunéré à l’heure, avec le recours possible aux heures supplémentaires.
Les seconds sont généralement des cadres. Ils ne comptabilisent pas leur temps de travail en heures mais en jours travaillés sur l’année. Ce système offre plus d’autonomie et permet la mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT). La contrepartie est qu’ils ne touchent pas de rémunération supplémentaire pour des heures travaillées au-delà d’une durée quotidienne standard.
Le passage d’un salarié d’un régime horaire vers un forfait jour est un signe de progression. Il est souvent le reflet d’une montée en responsabilité vers une fonction d’encadrement ou de pilotage d’activité avec une autonomie accrue. Néanmoins, cette évolution structurelle entraîne la disparition des heures supplémentaires, et donc de leurs avantages fiscaux. C’est précisément là que se cristallise la difficulté.
Étude de cas : une startup française en croissance
Prenons l'exemple d'une startup française qui a connu une croissance rapide. Au départ, avec une équipe de quelques employés, elle a mis en place un système de rémunération basé sur un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, complété par 4 heures supplémentaires défiscalisées. Ce modèle avait plusieurs avantages.
Les équipes, encore petites et homogènes, pouvaient facilement suivre le temps de présence. De plus, grâce à la défiscalisation, les salariés percevaient davantage en net, l'entreprise limitant le poids des charges.
Enfin, ce système souple convenait à une phase de développement rapide, où l'objectif premier était de stabiliser les équipes et d'assurer des rémunérations décentes dans un environnement assez fragile.
Au fil du temps, la startup a grandi, structuré ses services, et nommé des chefs d'équipe. Ces nouvelles responsabilités rendaient obsolète le système du pointage horaire. L'entreprise a naturellement souhaité faire évoluer ses collaborateurs vers un régime forfait jour. Cela semble plus cohérent avec leurs missions et leur autonomie. C'est lors de cette transition que les effets pervers du système de défiscalisation se sont révélés.
Les effets de bord identifiés
Un surcoût financier pour l'entreprise
Le passage au forfait jour implique la disparition des heures supplémentaires défiscalisées. Ces heures représentaient une part significative de la rémunération nette des salariés, avec un coût optimisé pour l'employeur. Pour maintenir le même salaire net après la transition, l'entreprise doit augmenter le salaire brut pour compenser la perte d'avantage fiscal. Mécaniquement, les charges patronales augmentent sur la nouvelle base salariale. L’effort financier repose entièrement sur l'entreprise, qui ne peut pas se permettre de baisser le salaire de la personne promue. Ce surcoût n'est pas lié à une augmentation de la valeur créée, mais à un simple changement de statut administratif et c’est là tout le problème.
Un impact fiscal négatif pour le salarié
Les heures supplémentaires défiscalisées ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Une fois passés au forfait jour, les salariés perdent cet avantage. À salaire brut égal, leur revenu net imposable augmente, ce qui peut se traduire par une baisse significative de leur pouvoir d'achat.
Pour corriger cela, l'entreprise est contrainte d'ajuster le salaire brut individuellement, afin de préserver le net perçu. Dans certains cas, pour qu'un salarié payé 55 000 € bruts annuels ne perde pas de revenu disponible, le surcoût global pour l'entreprise peut atteindre 5 600 € par an, combinant charges patronales additionnelles et ajustement de la rémunération brute.
Ce mécanisme crée une inégalité de traitement entre collaborateurs occupant des postes comparables, selon leur parcours de carrière interne :
Un salarié promu en interne peut se retrouver désavantagé par rapport à un recrutement externe déjà au forfait jour, faute d'avantage fiscal transitoire.
Le passage à un régime plus autonome devient paradoxalement financièrement dissuasif pour l'entreprise et parfois pour le salarié lui-même.
Une incitation négative à la mobilité interne
L'intention initiale de la défiscalisation des heures supplémentaires était de récompenser le travail additionnel. Cependant, appliquée dans un contexte de progression de carrière, elle introduit une distorsion. Cela pénalise la promotion interne et freine la mobilité ascendante des salariés vers des postes à responsabilité. L’entreprise doit compenser à double niveau (charges patronales et fiscalité du salarié).
La gestion salariale est complexifiée par des ajustements individualisés selon la situation fiscale de chaque collaborateur. Cela a pour effet de rajouter du travail administratif complexe et chronophage.
Pour des entreprises en forte croissance, notamment des PME et des startups, ces surcoûts non-productifs représentent un frein. Elles se trouvent face à un dilemme : soit retarder des promotions pourtant méritées, soit alourdir leur masse salariale pour un gain net nul en termes de création de valeur.
Pistes de réflexion pour une correction
Pour pallier les effets pervers susmentionnés, on pourrait imaginer un mécanisme transitoire. L'idée est de permettre au salarié de conserver, l'avantage fiscal dont il bénéficiait sur ses heures supplémentaires, même s'il passe au forfait jour. Cela lui permettrait de s'adapter à son nouveau statut sans subir de baisse immédiate de son revenu net. Pour l'entreprise, cela éviterait de devoir augmenter brutalement le salaire brut pour compenser la perte de cet avantage.
Une autre solution peut être d’instaurer un crédit d'impôt employeur. Cette idée suppose un incitatif financier direct pour les entreprises qui promeuvent leurs employés. Lorsque l'entreprise fait passer un salarié au forfait jour, elle pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Celui-ci viendrait compenser une partie des surcoûts liés à l'augmentation des charges patronales et de la masse salariale brute nécessaire pour maintenir le salaire net de l'employé. Cette mesure encouragerait financièrement les entreprises, notamment les PME, à promouvoir leurs collaborateurs.