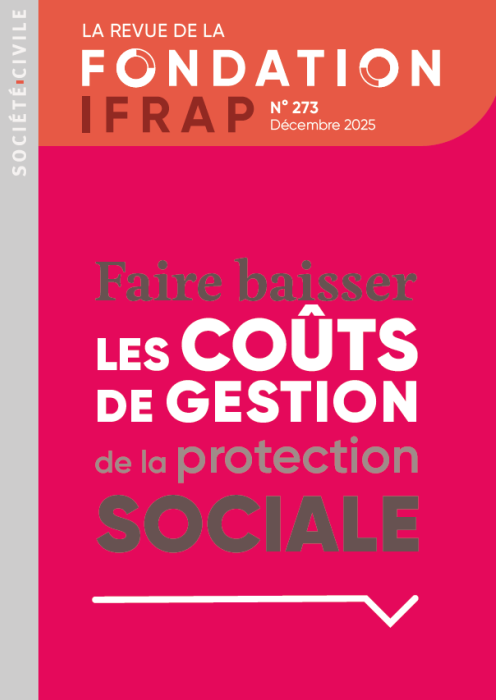Les coûts de la complexité administrative

Bridée par la déferlante normative, la France pâtit d’une complexité administrative élevée. Tandis que le nombre de textes et le volume des lois s’élèvent sans cesse, le coût des conséquences des normes excessives peut être évalué à un minimum de 100 milliards d’euros par an. 80 % de ces charges administratives pèsent sur les entreprises. En s’inspirant de ce que réalisent certains voisins européens, il est possible de réduire ce poids problématique.
| Cet article a été publié le 29 octobre 2025 dans la revue Constructif |
La France compte aujourd’hui 69 codes en vigueur contre moins de 20 en moyenne dans les autres pays européens. Les contenus de ces nombreux codes sont eux-mêmes en croissance rapide. Il en va de la sorte pour les lois, les règlements et autres textes de droit. Or, avant de créer de la norme, aucune mesure n’est prise pour savoir si cela sera bénéfique ou coûteux pour les Français et leurs entreprises. En résulte un excès de normes qui décourage l’investissement, freine l’innovation et ralentit la croissance. Tout cela engendre un climat morose qui rebute les nouveaux investisseurs. En découle mathématiquement une contribution à l’augmentation du déficit public par minoration de la croissance.
Des promesses de longue date
Le moins que l’on puisse affirmer, c’est que le problème ne se trouve pas dans le diagnostic. Depuis Georges Pompidou, alors Premier ministre, et sa phrase choc : « Arrêtez d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre, et, vous verrez, ça ira beaucoup mieux », on a vu fleurir une myriade de programmes de réduction de cette bureaucratie infernale. Jean-Pierre Raffarin voulait déjà, en son temps, réduire les formulaires pesant sur les entreprises et accélérer l’adoption des nouvelles technologies dans l’administration pour faciliter les démarches. Nicolas Sarkozy, avec sa révision générale des politiques publiques (RGPP), visait une meilleure efficience de celles-ci. Cela a, entre autres, permis de réduire l’impôt papier (coûts induits par les formalités administratives dont les entreprises doivent s’acquitter). Même François Hollande s’y est attelé. Avec son « choc de simplification », il comptait faciliter la vie des particuliers et des entreprises. Enfin, le président Emmanuel Macron s’est aussi largement prononcé en faveur de cette réduction normative tout en la laissant « en même temps » exploser.
Entre 2008 et 2012, la France s’était essayée à quantifier l›enfer de la bureaucratie. L’idée était ambitieuse : mesurer la charge administrative de chaque réglementation. Elle a vite tourné court, étouffée par la lourdeur du processus de saisie des données qu’elle était censée combattre. Toujours pour libérer particuliers et entreprises, le gouvernement Ayrault promettait, en 2013, de moderniser l’action publique pour essayer de gommer 3 milliards d’euros de déficit. Un Cimap, grand comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, fut créé dans cet esprit. Quelques années plus tard, en janvier 2018, Édouard Philippe affirmait sa volonté qu’aucun projet de loi ne sorte sans mesures de simplification, promettant des économies « en milliards » pour les entreprises. Rien ne vint. Début 2024, Gabriel Attal dénonce à son tour, dans son discours de politique générale, une France étouffée sous les normes, les agriculteurs en première ligne. Le Premier ministre affirme alors vouloir « débureaucratiser » la France. La loi Pacte 2 qui a suivi ses annonces devait alléger la machine, mais la dissolution de l’Assemblée nationale l’a enterrée sans débats.
Quantifier et évaluer l’augmentation du volume normatif
Afin de disposer d’une meilleure vision du stock et de l’augmentation de notre droit, nous disposons d’une ressource intéressante. Le tableau de bord 2024 du secrétariat général du Gouvernement, qui ausculte depuis 2018 l’évolution du droit national, révèle un chiffre saisissant : notre arsenal juridique totalise désormais 45.3 millions de mots. Vingt ans plus tôt, il en comptait deux fois moins. Voilà donc le fameux « poids des mots » qui écrase le pays.
Entre 2002 et 2024, le volume des articles de lois et de règlements a explosé de 164 %. Nous sommes passés de 216 347 à 354 223 articles, soit 137 876 de plus en deux décennies. La déferlante est générale, mais certains textes sont particulièrement touchés, à l’instar du gigantesque Code de l’environnement (volume multiplié par dix et plus d’un million de mots), du Code de la santé publique (× 3), et du Code général des impôts (× 2).
Si l’on regarde précisément ce qui a été produit depuis 2002, le bilan réel s’élève à ٤٢ 525 normes : 1 063 lois promulguées (dont 656 projets et 407 propositions) et 41 427 décrets. Ensemble, elles représentent déjà 63,42 millions de mots. Et encore, on estime que seules 30 000 de ces normes seraient réellement applicables. À cela s’ajoutent plus de 10 000 circulaires recensées en 2023.
Il y a bien des essais qui sont menés pour ralentir ce raz-de-marée. En 2018, le Sénat a lancé la mission BALAI (pour Bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles) afin de traquer et de supprimer les lois inapplicables ou dépassées, qualifiées de « fossiles législatifs ». L’opération a commencé par un dépoussiérage des textes adoptés entre 1800 et 1980. Résultat ? À peine une centaine de lois abrogées.
Pourquoi les politiques de simplification échouent-elles ? En plus du fait que l’on ne dispose pas de données officielles et à jour concernant notre stock de normes, trois éléments entrent en compte. Premièrement, il n’existe pas d’autorité indépendante chargée de surveiller la production normative. Deuxièmement, les études d’impact sont inexistantes ou superficielles et aucune évaluation du stock existant n’est tentée. Troisièmement, l’action administrative privilégie la réglementation au détriment de l’efficacité. Depuis l’adoption du principe de précaution, on réglemente d’abord, on verra ensuite l’effectivité de la mesure. C’est d’ailleurs valable pour l’Union européenne, comme l’a signalé Mario Draghi : en matière d’IA, on a commencé par faire un règlement sur le sujet alors qu’on n’a pas encore en Europe de licornes dignes de ce nom dans ce domaine !
Un coût des normes à 100 milliards…
La Fondation IFRAP estime le coût de la complexité administrative à 100 milliards d’euros par an, au minimum. Chiffre désormais repris par l’Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement, quand il y en a un. La réalité est que, sur le coût des normes, la France tâtonne toujours, alors que la plupart de nos voisins européens se sont saisis du sujet dès les années 2000 et avec des résultats concluants. L’Union européenne elle-même fixait en 2006 une réduction de 25 % des coûts administratifs dans les États membres. À cette date, la Commission européenne estimait que le coût des charges administratives représentait 3,7 % du PIB pour la France.
De son côté, en 2007, l’OCDE estimait le coût total des charges administratives pesant sur les entreprises à 60 milliards d’euros, soit 3 % du PIB de l’époque. Une estimation reprise en ٢٠١٧ par le Sénat notamment. La même année, le dernier rapport des dirigeants d›entreprise du Conseil de la simplification évoquait que, « pour la France, les estimations souvent avancées par plusieurs organismes portent sur une fourchette allant de 75 à 100 milliards d’euros ». On peut en conclure que le poids des normes pèserait entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. De ce total, la part des charges administratives pesant sur les entreprises oscillerait entre 75 et 80 %, soit entre 75 et 87 milliards d’euros. Si la France appliquait l’objectif européen d’une simplification de 25 % des normes, le gain potentiel serait d’environ 20 milliards d’euros pour les entreprises et d’environ 4 milliards pour les collectivités, les services publics et les particuliers. On en est encore loin.
Ces dernières années, la loi la plus prolifique, et la plus chère, en normes dans l’Hexagone est vraisemblablement la loi Climat et résilience. Où étaient les chantres de la simplification par exemple quand le Parlement a voté cette loi qui est un monstre bureaucratique, qui impose des tas de nouvelles normes ? Votée en 2021, elle introduit la généralisation dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici à 2025 des zones à faibles émissions, les fameuses ZFE. En clair : on interdit dans les centres-villes la circulation des véhicules Crit’air 5, 4 et 3. Cela concerne 35 % du parc automobile français, soit environ 13,8 millions de voitures !
L’interdiction de louer des logements avec des diagnostics de performance énergétique (DPE) G ou F, soit 5,2 millions de logements interdits à la location entre janvier 2025 pour les G et janvier 2028 pour les F ? Toujours la loi climat et résilience ! Et le ZAN (zéro artificialisation nette), dont les maires se plaignent amèrement et qui est incompréhensible, car personne ne sait calculer la division par deux de l’artificialisation des sols ? Loi climat et résilience aussi !
Dont 20 milliards environ de normes européennes
Vingt milliards, voilà l’estimation annuelle du poids des normes européennes sur la France. C’est à partir des données 2022 de la Commission européenne et de son programme REFIT (regulatory fitness and performance programme), chargé de lutter contre l’inflation normative, que la Fondation IFRAP estime les charges administratives émanant de l’Union européenne à 120 milliards d’euros environ en 2022. On parle ici de l’ensemble des coûts (ou « impôt papier ») dus aux obligations que la réglementation et les normes imposent aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises.
Alors que le PIB de la France représente 17 % de l’Union, on peut estimer que la part des charges administratives européennes pesant sur notre pays est de 20 milliards d’euros. Cela veut dire que sur l’impôt papier que nous subissons en France – environ 100 milliards –, 80 % émanent de l’activité législative nationale, 20 % de l’activité européenne.
Les Allemands, leaders incontestés sur ces questions, estiment que ce sont les entreprises qui sont les plus impactées par les normes européennes. Depuis 2015, en Allemagne, 56 % des coûts de « mise en conformité » pour les entreprises sont imputables à la transposition des normes européennes, alors que, symétriquement, ces dernières n’ont bénéficié que de 20 % des « économies » dégagées.
Particulièrement conscients de cet enjeu, nos voisins évaluent systématiquement les initiatives européennes (avant même qu’elles soient votées !) et cherchent à compenser l’impact des normes nouvelles par l’application stricte du « one in, one out » (une norme ajoutée, une norme supprimée) et suivent cette balance grâce à un index annuel. Loin de cela, côté français, une directive européenne sur quatre fait l’objet d’au moins une mesure de surtransposition avec un effet pénalisant.
Pour schématiser, il existe deux grandes catégories de normes européennes : les règlements et les directives. Le premier cas désigne un acte juridique qui s’applique de la même façon et à la même date à tous les États membres de l’Union. Il vise à garantir une uniformité entre les pays membres, ces derniers ne pouvant pas changer le règlement avant de l’appliquer. Les directives européennes, quant à elles, sont plus souples car elles laissent une certaine liberté aux membres de l’UE. Ces dernières donnent des objectifs et un délai pour les atteindre. Chacun des États membres doit ensuite mettre en place une loi de transposition pour l’adopter, car son application n’est pas directe. La directive est donc plus souple : elle permet une adaptation aux différents contextes politico-économiques. En plus de ces deux composantes, il existe aussi les décisions, les avis et les recommandations, et tout cela forme le droit européen.
Dans sept cas sur dix, en France, nous surtransposons et ajoutons donc de la norme sur la norme par rapport à nos voisins. La loi Climat et résilience en est un parfait exemple : le DPE existe ailleurs en Europe mais sans la caractéristique contraignante que la loi de 2021 lui a donnée en France. Les ZFE existent ailleurs en Europe mais certaines villes européennes ont reculé. L’impression que cela donne, c’est que ni la Commission européenne ni les autorités françaises ne souhaitent faire vraiment la transparence sur le poids des normes qui pèsent sur nos activités, qu’elles viennent de l’Union ou de la France.
Des répercussions dramatiques
Les effets pervers de cette surcharge normative sont nombreux et concrets. L’enfer réglementaire freine la croissance, réduit les marges des entreprises et limite les créations d’emplois. Par voie de conséquence, les recettes fiscales sont moindres. Cette spirale négative finit par augmenter le déficit chronique de la France. À la fin du premier trimestre 2025, la dette publique française atteignait 114 % du PIB (3 345,8 milliards d’euros). Chaque norme inutile est un coût caché pour l’État, qui consacre des milliards à la gestion de règles souvent inefficaces plutôt qu›à l›investissement productif. C’est aussi un frein pour les entreprises existantes et pour les futurs entrepreneurs.
À titre d’exemple, en mai 2023, Bridor – spécialiste breton des viennoiseries surgelées – jette l’éponge six ans après le lancement d›un projet d’ampleur à Liffré. Celui-ci devait générer 500 emplois et répondre à une forte demande internationale. Pourtant, les recours environnementaux répétés ont ralenti le processus au point de rendre le projet économiquement irréalisable. Malgré toutes les autorisations, il aurait fallu attendre au mieux jusqu’en 2028 pour voir l’entreprise tourner. Le président fondateur, Louis Le Duff, explique : « Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre dix ans ! » À l’étranger, les industriels similaires obtiennent les mêmes agréments en un à deux ans. Face à ces blocages, l’entreprise mise désormais sur des sites au Portugal et aux États-Unis.
La France est donc grande perdante. Elle perd peu à peu son tissu productif, ses emplois et sa croissance. Difficile à entendre quand les politiques de tous bords prônent la réindustrialisation.
Réduction des normes : une dynamique inspirante ailleurs en Europe
De nombreux pays européens ont créé des instances pour faciliter le contrôle des normes. Ainsi, aux Pays-Bas, la société indépendante et privée Sira Consulting a développé le dispositif CAR (cost driven approach), calculant les coûts administratifs liés aux réglementations et identifiant les sources les plus coûteuses.
En Belgique, l’Agence pour la simplification administrative (ASA) a permis de réduire les charges administratives de 3,48 % à 1,66 % du PIB entre 2000 et 2014.
L’Allemagne s’est fixé, en 2006, un objectif de réduction de 25 % des coûts administratifs pour les entreprises, atteint en six ans. L’organisme qui pilote cette action est le Nationaler Normenkontrollrat. De la même façon que l’ASA, il est lié à l’État par la loi qui annonce sa création, mais il reste entièrement indépendant pour ce qui est de son action.
Les initiatives étrangères ont été si efficaces que sept nations se sont regroupées au sein de RegWatchEurope pour suivre les politiques européennes en la matière.
La plupart de nos voisins appliquent aujourd’hui une gestion stricte : l’impact bureaucratique de chaque nouvelle norme est étudié avant même sa promulgation. La norme entrant en vigueur doit être compensée par la suppression d’une autre (« one in, one out »). Tout cela est suivi par un index annuel.
Notre surcharge administrative n’est pas une fatalité
Pourquoi l’inflation normative pose-t-elle problème ? Parce qu’elle engendre des coûts inutiles qui freinent nos entreprises et ralentissent nos services publics et les démarches de tous les jours pour les particuliers. Au niveau de l’industrie, moins de 30 % des projets d’implantation d’usines se concrétisent dans les deux premières années. Un temps anormalement long qui est la conséquence directe de la lourdeur des procédures exigées sur le terrain.
La lutte contre l’inflation normative ne peut pas reposer sur la seule volonté politique de nos dirigeants : il faut mettre en place des outils pour évaluer les normes, les contrôler et les simplifier. Un travail ambitieux mais réalisable si l’on suit les méthodes déjà appliquées en Allemagne ou en Belgique. Des pays qui évaluent en permanence leurs stocks de normes et mesurent l’impact des nouvelles, même celles émanant du droit européen, pour leurs entreprises, leurs collectivités et pour les citoyens.
Quelles mesures appliquer tout de suite ?
Des pays comme l’Allemagne, la Belgique ou le Royaume-Uni ont prouvé qu’il est possible de réduire le poids des normes. Voici les propositions de la Fondation IFRAP.
Évaluer la charge administrative en milliards d›euros chaque année, pour les entreprises et les ménages. En quantifiant réellement la perte financière liée à ce fléau, on accentue l’aspect urgent d’une action forte. Il sera aussi plus facile d’évaluer les progrès en se basant sur cette donnée qui servira de référence.
Instaurer le « one in, one out ». Pour avoir le droit de créer une norme, il faut en supprimer une autre que l’on considère comme obsolète et, si possible, à coût administratif plus faible ou égal. Si le coût est supérieur, mettre en place une règle de gage afin de compenser la différence en simplifiant ou dérégulant davantage.
Rendre les études d’impact chiffrées obligatoires, y compris sur les amendements. Cette évaluation permettra notamment aux parlementaires de légiférer en toute connaissance de cause.
Avoir une autorité réellement indépendante avec droit de saisine du Conseil constitutionnel pour contrôler les normes. Pour cela, il suffit d’étendre les prérogatives du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour évaluer le flux annuel de normes sur les entreprises et les ménages, au-delà des collectivités. L›autorité pourra également questionner la qualité des études d’impact fournies par l’administration.
Limiter la surtransposition des normes européennes. Pourquoi infliger aux Français et aux entreprises un traitement plus défavorable que dans les autres pays de l’UE ?
Appliquer le principe de subsidiarité. La responsabilité politique dépend de l’organe le plus proche du problème. C’est lui qui est le plus à même de créer la solution efficiente.
Soumettre certaines normes à votation citoyenne, à la suisse.
Supprimer ou fusionner les administrations/opérateurs en doublon pour simplifier les processus de décision.
Réaliser des sondages annuels ou biennaux auprès des entreprises afin d’évaluer l›impact des mesures de simplification avec le retour du terrain.