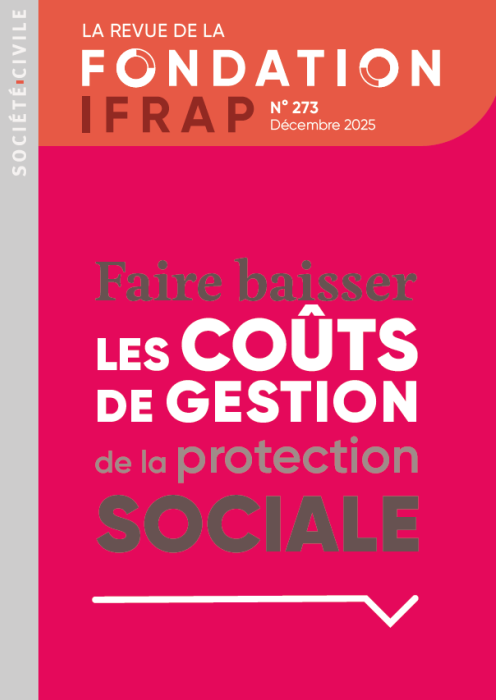Entretien : Essai sur une réforme territoriale impensée

Jean-Charles Manrique, auteur de l'ouvrage La division territoriale. Essai sur une réforme impensée et directeur général des services du conseil général du Loiret, répond ici aux questions de la Fondation iFRAP sur la réforme territoriale et son analyse du projet gouvernemental.
 Fondation iFRAP : Vous publiez un livre intitulé "La division territoriale. Essai sur une réforme impensée". Pourquoi ce titre ? Que reprochez-vous à la réforme actuelle et à toutes les réformes qui se succèdent en la matière ?
Fondation iFRAP : Vous publiez un livre intitulé "La division territoriale. Essai sur une réforme impensée". Pourquoi ce titre ? Que reprochez-vous à la réforme actuelle et à toutes les réformes qui se succèdent en la matière ?
Jean-Charles Manrique : Tout d'abord, pour éviter la confrontation simpliste entre anciens et modernes, que certains souhaiteraient voir traduite par une opposition tout aussi réductrice entre « les conservateurs et les réformateurs », je rappellerai ces mots du Général de Gaulle lors d'un entretien télévisé de décembre 1965 : « on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe ! », « l'Europe ! », « l'Europe ! » mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien ».
Pointer d'un doigt accusateur celles et ceux qui ne sautent pas tels des cabris à la seule évocation des mots « réforme territoriale » ne saurait que questionner, surtout lorsque les observations ou critiques ont été réfléchies et visent, à l'image des lanceurs d'alerte, à appeler à l'intelligence de situation, dans l'intérêt de la France.
Pareto disait avec justesse qu'une théorie peut être utile sans être vraie. « Justification n'est pas certification » (Raymond Boudon). Vouloir ainsi opposer les réformateurs aux conservateurs ne revient qu'à masquer le vide d'une « nouveauté » qui n'est parvenue à prouver ni son utilité, ni sa validité, autrement que par son unique « nouveauté ».
Nul ne conteste la nécessité de réformes structurelles, dans de nombreux domaines, y compris dans la sphère publique locale. D'ailleurs cet ouvrage ne se veut pas un plaidoyer en faveur des conseils généraux, ou d'une autre strate du millefeuille territorial, mais une critique fondée - et j'espère que le lecteur en conviendra —, sur des analyses étayées.
Pourquoi avoir employé le mot « division » ? Eh bien revenons un peu en arrière pour en comprendre le sens s'agissant du monde local. En 2012, les opposants à la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales (RCT), devenus alors la majorité parlementaire, ont décidé d'abroger par petites touches successives les principales dispositions d'un texte, qui pourtant aurait pu malgré ses défauts, d'une part entrer en application dès 2015, et d'autre part conduire à des économies budgétaires par le biais des conventions de gestion, et de liens de gouvernance incarnés par le conseiller territorial. Il y avait donc bien une réforme, votée et applicable, et qui a malheureusement été écartée. Le détricotage législatif a une fois de plus frappé.
Deux années et demie plus tard, les projets se sont succédé dans un climat de « stop and go » et dans une cacophonie gouvernementale telle, que la ministre en charge de ce portefeuille se voyait fréquemment contredite au sommet de l'Etat. Face à une incapacité à formaliser une réforme à la hauteur des évolutions que connaît la France, dans ses territoires, comme dans le visage et la localisation de sa population, le pouvoir en place a choisi une solution radicale et dont il a rapidement perçu l'intérêt médiatique, et l'écho qu'elle produirait dans l'inconscient d'un pays qui semble hermétique aux réformes progressives et consensuelles : la suppression des conseils généraux. Or, là où certains voient de l'audace et de la détermination, je ne vois qu'impréparation et désillusions quant aux résultats finaux. Force est de constater que le gouvernement lui-même a renoncé aux économies annoncées, tant elles paraissent aux yeux de tous comme incertaines et que des dépenses supplémentaires sont à présent évoquées. Quant au courage, renvoyer la suppression des conseils généraux à 2020 faute de majorité des 3/5ème au Congrès, et par crainte d'essuyer un vote négatif dans l'hypothèse d'un référendum, il conviendrait d'en modérer pour le moins les accents. Comment dès lors ne pas comprendre la division qui règne à présent dans le monde local, bien au-delà des frontières partisanes ?
Ainsi deux reproches majeurs peuvent être adressés à ces projets de réforme territoriale. Le premier est qu'ils ne reposent pas sur une volonté affirmée et observée dans les faits de rechercher un consensus - qui est pourtant nécessaire pour garantir le bon achèvement de textes sans cesse remis en cause - , afin de susciter l'adhésion la plus large possible, synonyme d'efficacité et d'efficience publiques. Le dernier épisode du caractère impensé de ces projets de réforme, d'ailleurs étonnamment passé sous silence par les médias, est le calendrier électoral des élections locales. En juillet dernier, face à la multiplication des critiques relatives à l'objectif d'économies budgétaires annoncé par M. André Vallini, il était présenté une étude d'impact qui affirmait avec force la nécessité du couplage des élections régionales et cantonales, et leur tenue en décembre 2015, pour permettre aux citoyens de voter en toute connaissance de cause quant aux nouvelles compétences et ressorts des collectivités territoriales. Quelques semaines plus tard, le Premier ministre soutient tout le contraire à l'Assemblée nationale. La démocratie de confiance paraît alors un horizon lointain.
Le second reproche est celui que je qualifierai de l'évitement. Tous les gouvernements depuis deux décennies sont parfaitement informés de la dérive des dépenses sociales, dont le déficit de financement pour les allocations de solidarité avoisine les 50 Mds€ sur 10 ans, avec une perspective de déficit de 2,3 Mds€ d'ici 2017. Les conseils généraux seront déjà en cessation de paiement que les dispositions de la loi auront à peine été votées, et ce alors même que les métropoles et les grandes agglomérations ont fait savoir qu'elles refusaient le principe de se voir transférer les dépenses de solidarité.
L'impérieuse nécessité de la France est de revoir ses politiques publiques, c'est-à-dire leur contenu, leurs niveaux, leurs critères, etc., de les ajuster aux ressources réelles du pays, et non de faire un tir de diversion en désignant une victime expiatoire –les conseils généraux — , dont les effectifs ne représentent pas même un quart de ceux des communes et intercommunalités, et qui affichent une progression sensible ces dernières années. Un tel courage permettra de dégager des économies dans des délais rapprochés.
S'agissant de la réforme des niveaux d'administration, permettez-moi de rappeler que notre histoire a démontré l'utilité d'un temps de réflexion suffisant pour asseoir correctement les évolutions de fond, qui touchent un tel nombre d'aspects essentiels de la vie quotidienne de nos concitoyens, que vouloir effacer notre mémoire administrative et territoriale après un bref et maladroit cours magistral de cartographie me paraît menacer des équilibres déjà fragiles. Ces mêmes équilibres qui aujourd'hui assurent tant bien que mal une certaine stabilité dans l'ensemble des territoires de notre pays.
Les économies résident principalement dans les dépenses d'intervention (sociales, culturelles, application de normes, etc.), dont les critères sont majoritairement fixés…par le législateur et l'Etat. Il leur revient de les mettre en adéquation avec les réalités du temps. Les dépenses de structure, liées à la structure même et au nombre des collectivités territoriales, elles dépendent certes de décisions locales (mutualisations, politiques facultatives, dérives résultant de la clause générale de compétence, etc.), mais aussi et surtout de charges fixes et décisions relatives à la fonction publique territoriales relevant…de l'Etat. C'est pourquoi je propose des principes de gestion publique où la transparence, l'évaluation ex ante et ex post des décisions politiques, seraient complètement revisitées, et le passage à une fonction publique d'emplois, réservant ainsi le statut à un nombre restreint de fonctions, notamment dans les missions régaliennes de l'Etat. D'autres pays l'ont fait, dans un esprit ouvert et dans le dialogue social, et les résultats ont été au rendez-vous.
Fondation iFRAP : Vous évoquez l'exemple du Loiret où "il existe, aux côtés d'un conseil général comptant plus de 2600 agents, 221 structures intercommunales (les intercommunalités et syndicats en tous genres) employant plus de 1 700 agents titulaires et stagiaires (agents contractuels et agents de 76 syndicats intercommunaux non comptabilisés à ce jour)." À quel point ces différentes structures doublonnent-elles entre elles ?
JCM : J'ai souhaité, au travers de cet exemple, certes montrer les doublons à l'échelle infradépartementale, mais surtout appeler l'attention du lecteur et des décideurs sur ce qui, à mon sens, devrait être l'objet d'une priorité d'action en parallèle de celle concernant la refonte des politiques publiques nationales, c'est-à-dire la réduction de la « crème pâtissière » composée d'une multitude d'acteurs publics et parapublics, alors que toute l'attention est focalisée sur les médiatiquement fragiles couches du « millefeuille » des collectivités territoriales.
En effet, il ne semble pas porteur, selon le vocable usité, de se concentrer sur les innombrables structures privées, associatives, établissements publics, bailleurs sociaux, etc. qui se voient confier de droit ou par voie conventionnelle des politiques publiques locales, financées par les collectivités territoriales, ou garanties par leurs budgets (cf. les garanties d'emprunt accordées par les conseils généraux aux bailleurs sociaux et établissements d'accueil de personnes âgées ou handicapées, et sans lesquelles aucun projet ne pourrait aboutir). Pour preuve de leur importance dans la vie réelle, dès qu'une collectivité décide de réduire ses financements à ces acteurs, la levée de boucliers est immédiate au nom de la solidarité, et autres éléments de langage parfaitement rodés, ces acteurs affichant des évolutions de masse salariale supérieure à celle des personnes publiques du fait de leur alignement sur des conventions collectives, qui ne sont pas frappées, elles, par le gel du point d'indice…
Or le courage de la réforme ne paraît pas atteindre ces acteurs, à commencer par les différentes caisses liées au système de la sécurité sociale, dont une étude récente de la Cour des comptes vient de mettre en évidence un mécanisme de rémunérations et d'avantages en nature très confortables, et dont l'évolution ces dernières années ne semble pas avoir été marquée par le sceau de la rigueur.
En conséquence de quoi, et pour rester cohérent avec le fil de mon ouvrage, je propose non la suppression pure et simple des conseils généraux et de toute autre strate, mais un examen attentif des politiques publiques en appliquant deux principes que l'ensemble de nos concitoyens peuvent comprendre. D'abord un principe d'unicité de chacune des politiques publiques : soit une politique publique pour un niveau de collectivité publique, ni plus, ni moins. La clause générale de compétence aura ainsi vécu, à l'exception des dépenses d'investissement productives (très haut débit, immobilier économique, etc. et non pour des équipements publics générateurs de dépenses de fonctionnement). Puis un principe de subsidiarité : soit le positionnement de la politique publique à l'échelon le mieux justifié. À cet égard, il me semble que le département (et bien qu'il puisse en rester un nombre réduit en métropole comme en outre-mer) est mieux adapté à accueillir la compétence des collèges et des lycées, en intégrant la gestion de l'ensemble des personnels, y compris les personnels de l'Éducation nationale, qui se verraient ainsi transférés.
En résumé, une réforme profonde des collectivités territoriales ne saurait oublier une telle analyse de la cartographie des acteurs des politiques publiques, dont bon nombre d'entre eux restent silencieux, et évitent avec un soin tout particulier les projecteurs médiatiques, de crainte de se voir concernés par un examen qui pourrait mettre en évidence des pistes intéressantes de rationalisation.
Fondation iFRAP : Vous semblez mettre en doute dans votre ouvrage le fait que l'on puisse réaliser des économies sur les dépenses locales. Quelles seraient, selon vous, les économies à réaliser ? Vous évoquez notamment les dépenses de fonctionnement, les dépenses culturelles et sportives etc.
JCM : Pardonnez-moi, mais je pense tout le contraire.
Ce que je remets en cause, ce sont les économies annoncées comme « certaines » du simple fait d'une nouvelle carte régionale et de la suppression des conseils généraux. Il serait long de tout détailler ici, et j'invite vos lecteurs à la lecture de mon ouvrage, et à ne pas hésiter à me faire part de leurs avis. Je serai heureux d'échanger avec eux.
La maîtrise des dépenses publiques est un impératif d'intérêt général. Et je soutiens qu'il est possible de parvenir à des économies importantes sans même toucher à l'organisation territoriale actuelle. Cessons de tout confondre, et d'être influencé par des projets et des réformes qui n'en ont que le nom, et en sont très éloignées dans l'esprit.
Par l'effet conjugué de trois décisions politiques, il serait possible, et dans des délais rapprochés, de dégager des économies conséquentes : d'abord en actionnant les leviers de la baisse de la dépense publique (une simplification immédiate des normes imposées aux collectivités territoriales, la massification des achats, la priorisation des dépenses d'investissements productifs, une nette réduction des subventions de fonctionnement, la pause dans les dépenses sociales, l'interdiction des financements croisés sauf pour les investissements productifs, et enfin l'accroissement du contrôle et de l'encadrement des opérateurs de services publics) ; puis en appliquant les principes d'unicité et de subsidiarité aux politiques publiques, et ainsi interdire les financements croisés, supprimer la clause générale de compétence et écarter les compétences partagées prévues par le gouvernement tel un ersatz de la clause de compétence générale. Est-il par exemple cohérent que de nombreuses collectivités territoriales continuent à financer avec l'argent des contribuables des clubs sportifs de haut niveau, qui affichent des rémunérations surprenantes, et se plaignent des mesures nationales de régulation ? Les moyens ne sont plus là, et il conviendrait d'en prendre enfin conscience, comme des difficultés des contribuables acquittant effectivement l'impôt local ; enfin réformer la fonction publique et ses mécanismes, par souci d'équité et d'égalité, et en cohérence avec le recentrage à l'Etat des missions régaliennes. Dans un terme rapproché, seuls certains emplois régaliens entreraient dans le cadre du statut, avec des règles revisitées dans le seul intérêt du service public. Les emplois actuels soumis au statut s'éteindraient progressivement, avec cependant des modifications dans les règles du GVT et des avancements, dans le but de garantir une réelle maîtrise de la dépense publique et la reconnaissance du mérite des agents. Des pays sont parvenus, dans un dialogue social responsable, à réformer leur fonction publique, avec des résultats assez positifs, et notamment une baisse des effectifs programmée et accompagnée, et des niveaux de salaires sensiblement accrus à l'issue du processus de réforme.
J'oubliais un autre point essentiel : le législateur ne devrait plus adopter des mesures nouvelles sans avoir la possibilité de recourir en amont à une expertise indépendante et reconnue (à l'image d'un « Gouvernment Accountability Office » - GAO, USA), qui serait rattachée au Parlement et viendrait se substituer à la Cour des Comptes. Cette expertise permettrait au Parlement de saisir correctement les incidences financières, et donc leur soutenabilité, de ces mesures dans un contexte de tensions budgétaires et fiscales sans précédent.
Fondation iFRAP : Vous proposez une nouvelle répartition des missions entre les échelons, de supprimer les financements croisés, de supprimer la clause générale de compétence et vous mettez en avant l'idée de contrats de gestion, de fusionner les communes avec les intercommunalités, les départements entre eux et les régions entre elles. Quel est, selon vous, le bon nombre de régions, de départements et de grosses communes ?
JCM : Chaque citoyen peut saisir l'évidence de ce propos : « Qui prescrit, paie ». Malheureusement, tel n'est pas le cas dans notre République, dont l'organisation est semble-t-il décentralisée, alors que tout procède, ou presque, de la volonté du législateur. Peu de nos concitoyens le savent et le comprennent lorsqu'ils s'adressent à un élu. Face à une telle situation, illogique dans leur esprit, le crédit des élus locaux en pâtit, au point parfois de subir le même sort que les élus nationaux dans l'échelle de la confiance de nos concitoyens.
Je suis revenu dans vos questions précédentes sur la nécessité de clarifier réellement, c'est-à-dire d'abord par le biais de la refonte des politiques publiques, puis de l'identification précise des responsabilités nationales ou locales (les principes d'unicité et de subsidiarité appliqués aux politiques publiques).
Dans la suite de cette clarification, il est également important de se pencher sur les « outils » de gestion dont disposent les collectivités territoriales. Force est de reconnaître que la culture de gestion, bien que présente en raison de la règle de l'équilibre budgétaire qui s'applique contrairement au budget de l'Etat, nécessiterait une modernisation d'envergure, tant dans ses principes que dans ses outils. La règle d'or, consistant à imposer un optimum d'épargne pour que les collectivités locales demeurent des investisseurs et non des « redistributrices » de fonds publics sans valeur ajoutée aux prélèvements, me paraît réellement importante.
De même, le choix actuel de complexifier toujours plus les règles d'attribution des dotations de l'Etat pour répartir la pénurie, et, plus grave, d'instaurer des mécanismes de péréquation dont le seul effet sera à terme d'appauvrir les territoires dynamiques, doit être remis en cause. Est-il normal et acceptable dans la durée que des collectivités dites « pauvres » affichent des taux d'administration très supérieurs à ceux des collectivités rigoureuses ? Non.
Est-il normal et acceptable que les collectivités bénéficiant des fonds d'urgence annuels ne rendent pas compte devant leurs assemblées et la représentation nationale, et ne soient pas auditer chaque année pour juger des efforts mis en œuvre en contrepartie des aides accordées ? Non.
Voilà pourquoi je propose des contrats de gestion, en priorité pour les collectivités en difficulté, et de manière plus globale, pour l'ensemble du monde public local, étalés sur la durée de la mandature avec une révision tous les deux ans. Ces contrats ont un sens : l'Etat ne pourrait plus imposer des dépenses supplémentaires aux collectivités locales sans une réelle transparence, et ouvrirait enfin les yeux sur l'impossible financement à terme des allocations de solidarité ; quant aux collectivités locales, elles s'engageraient dans la voie de la mise en œuvre des leviers de gestion proposée dans mon ouvrage, sans tarder. Les dotations pourraient varier en fonction du niveau d'atteinte des objectifs et de la détermination observée. Une telle responsabilisation rendrait la péréquation mieux supportable car mécaniquement mieux ciblée. La question de l'organisation territoriale est pour ma part la résultante et non le point de départ de ces évolutions du champ de nos politiques publiques et de leur mise en œuvre en termes de gestion notamment.
L'expérience en ce domaine m'a appris que la France est diverse, et qu'il conviendrait donc de ne plus écouter béatement des observateurs quelque peu ignorants du monde local, de sa diversité, de ses aspirations multiples, parfois contraires mais qu'il convient d'entendre pour préserver un pacte républicain digne de ce nom. Notons à cet égard les perceptions de la notion de proximité, qui ne revêt pas le même sens en milieu urbain et en moyenne montagne. Respectons avec humilité le fait que la France des territoires puisse ne pas obéir à un unique schéma dessiné en comité restreint, mais qu'elle se dessine à partir d'une collégialité d'expertises, de rencontres avec les citoyens, et surtout de sérénité dans les débats. Retrouvons le goût de l'échange, du respect dans la confrontation des idées. Le réflexe du raisonnement binaire « créer/supprimer » devient insupportable et insupporte nos concitoyens qui, à force, perdent toute énergie et foi dans leurs édiles.
J'ai donc tenu à présenter 3 scénarios allant du statut quo territorial à la suppression des conseils généraux, en passant par une réduction du nombre des collectivités dans chacune des strates sans supprimer d'échelon.
Je reconnais volontiers, après avoir longuement étudié l'évolution de nos territoires au travers des siècles, et réfléchi sur l'organisation des politiques publiques, que l'hypothèse d'une réduction du nombre des régions, affectées à une mission principale de développement, et de celui des départements, axés sur l'aménagement et les solidarités territoriales, me semble pouvoir être soumise à débat. À titre d'information, un travail récent a conduit à identifier 61 départements et 11 régions (y compris la Corse) dans le cadre d'une exploration des champs des possibles en matière d'organisation territoriale. Je crois, avec conviction à l'idée d'une région Méditerranée allant de Collioure à Menton, qui donnerait une impulsion politique forte à ce magnifique projet d'Union Pour la Méditerranée, et respecterait mieux les systèmes de territoire dans les domaines économiques, sociaux et culturels, en comparaison d'un rapprochement entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Mais là encore, écoutons-nous, construisons ensemble : les parts de vérités méritent d'être exposées et respectées. Il en sortira une « vérité », certes perfectible par nature, mais néanmoins saluée et sans aucun doute suivie car fruit d'une démarche positive.
Fondation iFRAP : Quelles sont les missions qui resteraient dans votre schéma, à l'État ? Est-ce que cela répondrait à l'idée que vous évoquez de "décoloniser la province" ?
JCM : Il me semble, et je vous remercie de poser cette question à la fin de notre échange, que la question essentielle pour notre République et son fonctionnement est bien celle-ci : quelles sont les missions qu'un Etat moderne doit assurer et par voie de conséquence l'organisation appropriée pour y répondre ?
Pour ma part, je suis convaincu que le modèle social français est à bout de souffle. Depuis la fin des années 1970, les signes de faiblesse se sont multipliés. Puis les conséquences des « trente piteuses » (Nicolas Baverez) se sont fait sentir, accentuées qu'elles furent par une mondialisation qui se révèle impitoyable lorsque les entreprises en viennent à analyser les avantages comparatifs des économies. Il est par ailleurs une évidence que les « baby bommers » ont bénéficié d'un modèle social qu'ils ont conforté et axé sur leurs intérêts propres, au détriment des équilibres fondamentaux, et des générations actives actuelles et futures. C'est pourquoi les mesures correctrices décidées sur le tard et par mesures successives ne peuvent que déplaire à tout le monde. La prise de conscience n'a pas eu lieu dès le début des années 1980, et une idéologie plaisante, mais en décalage total avec les réalités d'une mondialisation galopante (défendue avec la même énergie par les tenants de cette idéologie), s'est imposée, reléguant la relation au travail et à l'économie en général au rang de préoccupations secondaires, derrière le temps libre et un certain hédonisme…au frais de nos descendants.
À présent, l'économie de la redistribution a pris le pas sur l'économie. Pour un temps seulement car l'économie réelle nous rattrapera tôt ou tard, et ce moment approche rapidement. Un choc sur le taux auquel se finance l'Etat suffirait sans doute à faire s'effondrer cet édifice désormais fragile.
Il me paraît donc incontournable de revoir toutes les politiques publiques, à commencer par les politiques sociales, simplement parce que les dérives sont principalement sur ce poste, comme l'a remarquablement démontré M. Gilles Carrez, Président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le constat est aussi simple que redoutable : la France doit apprendre à vivre au niveau de ses moyens, et se doit de le faire pour conserver son statut de puissance mondiale. À défaut, son impuissance économique annihilera les derniers éléments de sa puissance (militaire, diplomatique, culturelle, etc.).
Il n'est pas question de remettre en cause tout l'édifice de l'État-providence, mais de le « recalibrer » pour le mettre en adéquation avec les ressources disponibles, et de tenir compte des contraintes des économies ouvertes, d'ailleurs jamais réellement expliquées à nos concitoyens. La notion de « Fair Trade » demeure encore un vœu pieu, et la régulation actuelle des échanges internationaux ne prend que peu en compte les standards de solidarité des économies occidentales, que les nouveaux fers de lance de l'économie monde aspirent à rejoindre au prix d'une compétition acharnée. Ou bien, il conviendra de choisir une autre voie, bien plus hasardeuse.
De même, nos concitoyens perçoivent bien les dysfonctionnements des politiques de sécurité intérieure, l'insuffisance de moyens de la Justice, et le délitement du système éducatif. Les missions régaliennes doivent donc être restaurées, et les autres politiques publiques largement décentralisées pour gagner en souplesse et en réactivité.
M. André Vallini reconnaissait lui-même il y a peu que les ministères ne lui proposaient pas avec énergie et vitesse des mesures de simplification, quand le pays n'en peut plus d'attendre. L'État est devenu lent, lourd et impuissant dans beaucoup trop de domaines.
Mais pour parvenir à ce modèle d'un Etat allégé, souple et efficace dans ses missions régaliennes, il est important de se représenter l'évolution connexe incontournable : la sortie de l'Etat unitaire dit décentralisé. C'est-à-dire réexaminer l'organisation territoriale de la République et faire un choix courageux et clair : soit adopter le projet du gouvernement de M. Manuel Valls, et accepter quoi qu'on en dise de redonner les clés des territoires aux représentants de l'Etat (Préfecture, ARS, DREAL, Rectorat, etc.), soit s'orienter vers un Etat régionalisé, qui n'est pas un Etat fédéral, mais une forme de nature politique de l'Etat qui donne aux régions de vrais pouvoirs pour tenir compte des réalités locales. Michel Rocard parlait de « décolonisation de la province » ; pour ma part cette confiance raisonnée et raisonnable donnée aux régions ne constitue pas une menace pour l'unité de l'Etat, et cesserait de limiter la décentralisation à un simple « processus d'évolution de l'organisation de l'Etat », comme la considérait le Conseil d'Etat au début des années 2000.
Avec le respect que j'ai pour M. Henri Guaino, je pense que ses critiques la réussite relative des collectivités territoriales s'explique pour une grande partie par un rendez-vous manqué avec la décentralisation, celle-ci ayant subi une évolution lente mais réelle vers une recentralisation que porte dans sa logique profonde le projet de loi d'organisation territoriale de la République. Celui-ci n'est qu'un nouvel épisode après les étapes visant à maîtriser les ressources des collectivités locales et leur évolution.
Que les Français décident : la continuation d'un centralisme organisé, qui a sa logique, mais avec des élus locaux ne maîtrisant ni leurs ressources, ni les dépenses locales issues de décisions nationales ; ou bien l'entrée dans une ère de décentralisation réelle, avec la responsabilité érigée en règle fondamentale, et en parallèle des contre-pouvoirs locaux revus et renforcés, afin de faire émerger une évaluation des politiques publiques locales digne de ce nom. Plus que la taille des territoires, la mobilisation d'énergies se sentant libres et responsables importe. L'organisation actuelle, et celle envisagée, n'y répondent pas, et n'y répondront pas.
Jean-Charles Manrique est, depuis 2012, directeur général des Services et, depuis 2014, directeur d'Approlys, la centrale d'achat territoriale du Conseil général du Loiret. Diplômé d'un DESS en administration et gestion publique en 1998, puis de l'Institut national des études territoriales en 2006, il a d'abord travaillé à la Mairie de Paris de 1995 à 2005, avant d'être nommé directeur général adjoint chargé du développement territorial du Conseil régional de Picardie en 2007, puis directeur général des services du Conseil général de la Manche en 2008 et de la communauté d'agglomération dracénoise (Var) depuis 2011.
Services et, depuis 2014, directeur d'Approlys, la centrale d'achat territoriale du Conseil général du Loiret. Diplômé d'un DESS en administration et gestion publique en 1998, puis de l'Institut national des études territoriales en 2006, il a d'abord travaillé à la Mairie de Paris de 1995 à 2005, avant d'être nommé directeur général adjoint chargé du développement territorial du Conseil régional de Picardie en 2007, puis directeur général des services du Conseil général de la Manche en 2008 et de la communauté d'agglomération dracénoise (Var) depuis 2011.