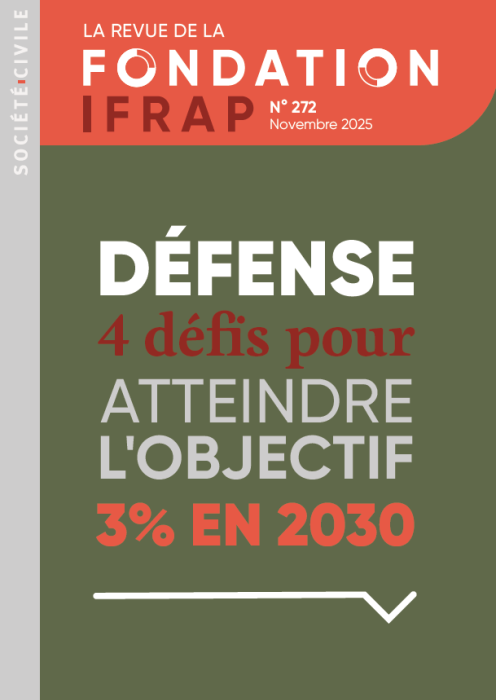Fonds de transformation de l’action publique (FTAP) : où sont les économies ?

La Cour des comptes vient de lancer une petite bombe sur la gestion du cofinancement des réformes de transformation publique post-CAP 2022. Le FTAP qui devait en assurer le financement aura coûté vraisemblablement fin 2025 environ 800 M€, et pourtant les économies dégagées ne s’élèveront qu’à 340 M€… Or le contrat de départ prévoyait « 1€ d’économie pour 1€ investi sur trois ans », soit 2 Md€ investis (dont 1 Md€ du FTAP) dégageant pour 2 Md€ d’économie… On en est finalement très loin. Les économies pérennes attendues ne sont pas au rendez-vous avec un ROI (retour sur investissement) en 2024 de seulement 0,5 (339 M€ d’économies pérennes pour 687 M€ consommés). Et qu’à financé ce fonds ? le Health data hub des données de santé dont les économies de 54 M€ ont été révisées à 500.000€, mais aussi les data center des directions générales des finances publiques, la procédure pénale numérique, le numérique en détention, France identité numérique, dématérialisation des demandes d’urbanisme et des déclarations foncières, le projet Pilat du système d’information fiscale de la DGFiP… Ou des simples dépenses d’équipement de la médecine légale… En tout 144 projets, mais certains recouvrant des centaines de sous-projets très émiettés.
Depuis 2018, près de 149 projets ont été soutenus dont 77% achevés en 2024
A la suite de la RGPP entre 2008 et 2012, de la réforme de l’administration territoriales de l’Etat en 2010 (RéaTE) et de la modernisation de l’action publique portée par le SGMAP à partir de 2011, le programme « Action publique 2022 » a été lancé en 2017. A cette occasion, un fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) a été créé en 2017 et rattaché au Grand Plan d’Investissement (GPI). Il a d’abord été doté d’une enveloppe initiale de 700 M€ permettant de cofinancer des projets de réforme et de modernisation de l’Etat à échéance de cinq ans (2018-2022). En 2023, la durée de vie du FTAP est prolongée jusqu’en 2025 et il est doté d’une enveloppe de 400 M€ supplémentaires pour atteindre 1,1 Md€.
A l’issue de l’audit du fonds que vient de rendre la Cour des comptes, il apparaît que seulement 77 % des 149 projets sélectionnés et cofinancés par le fonds ont été réalisé. Par ailleurs, 5 d’entre eux ont été annulé en cours de route, si bien que selon les métriques retenues, la DITP retient entre 144 et 149 projets.
| Coût des projets | Nbre de projet | Répartition du nombre de projets (%) | Montant des projets totaux | Répartition du montant des projets (%) |
| < à 1 M€ | 11 | 7,6% | 2,6 | 0,3% |
| entre 1 et 5 M€ | 47 | 32,6% | 61,3 | 7,9% |
| entre 5 et 10 M€ | 31 | 21,5% | 91,5 | 11,8% |
| entre 10 et 50 M€ | 50 | 34,7% | 535,2 | 69,1% |
| > 50 M€ | 5 | 3,5% | 83,9 | 10,8% |
| Total | 144 | 100,0% | 774,5 | 100,0% |
Source : DITP, Cour des comptes.
Un premier problème a résidé dans le trop grand émiettement des projets, sachant, comme l’indique d’ailleurs le SGG (secrétariat général du Gouvernement) dans sa réponse, que l’équipe de suivi du FTAP constituée par son secrétariat général « n’a atteint les cinq ETP décrits dans le rapport que de la mi-2023 à la mi-2024. Jusqu’à mi-2023, le FTAP était piloté par trois ETP. » Ainsi, ce sous-dimensionnement a aboutit à ce que « cette équipe restreinte [fasse] face à d’importantes tâches de gestion afin notamment de garantir la consommation des crédits du programme délégués aux ministères ». Le tableau ci-dessus montre que près de 7,6 % des projets ne représentaient que 0,3 % du montant total des projets financés. Par ailleurs, « la création de sous-fonds du FTAP (…) a démultiplié les projets : ainsi les enveloppes successives destinées aux services déconcentrés totalisent près d’une centaine de projets. » On trouve ainsi pêle-mêle des sous-enveloppes à destination des services déconcentrés de l’Etat (aides dites « concentrateur »), des aides aux projets numériques dites « guichet Dinum » et le fonds Vert de l’Etat (FVE).
Par ailleurs, les taux de cofinancement sont également extrêmement variables, oscillant entre 5 % et 95 %. Les petits projets obtenant des taux de cofinancement beaucoup plus importants que les plus gros.
| Part de cofinancement par le FTAP | Nombre de projets | Répartition du nombre de projets (%) |
| Entre 0 et 25% | 18 | 12,1% |
| Entre 25 et 50% | 65 | 43,6% |
| Entre 50 et 75% | 50 | 33,6% |
| Entre 75 et 100% | 16 | 10,7% |
| Total | 149 | 100,0% |
Source : DITP, Cour des comptes.
Seul point quasi-commun, la prédominance des démarches de transformation numérique, soit près de 80 % des dossiers financés (119 dossiers) incluant près de 60 initiatives d’IA depuis 2018. Le SGG précise cependant que les guichets Dinum ont permis de financer le déploiement de RPA (automatisation robotisée des processus – chatbot et autres) ainsi que des initiatives en matière de déploiement du l’IA (intelligence artificielle) et du cloud, soit 74 projets depuis 2023, 19 nouveaux projets en 2025 dont 10 en matière d’IA.
En revanche note la Cour, « l’objectif du fonds vert de l’Etat (FVE) de financer directement dans les services de l’Etat des petits, voire de très petits équipements, est difficilement justifiable. Il s’agissait souvent d’équipements courants, sans effet systémique sur le développement durable et la transformation des processus administratifs ». Ainsi le FTAP a à la marge été utilisé pour financer des dépenses d’équipement courantes des ministères ce qui n’était pas du tout sa vocation initiale, et des investissements parfois « infimes ». Le FTAP devant financer d’abord des grands projets transformants, mais aussi pour des enveloppes plus modestes, des « missions d’efficacité opérationnelle comme source de gains durables de productivité et d’amélioration de la qualité de service ».
Ainsi, initialement « aucun ciblage préalable n’a été fait pour privilégier les parties de l’Etat nécessitant les soutiens les plus vigoureux à la transformation publique (…). Il est notable par exemple que certains ministères soient peu présents : ceux chargés des affaires sociales, de l’éducation ou de l’environnement ».
Le choix critiquable de l’appel à projet (AAP) jusqu’en 2023Comme l’évoque le SGG lui-même en réponse au rapport d’observations définitives de la Cour des comptes, jusqu’en 2023, les cofinancements accordés par le FTAP passaient par des appels à projet (APP). Or cette procédure a pu conduire à des biais de sélection, écartant « des projets non proposés par certaines administrations, susceptibles d’en avoir davantage besoin, mais qui étaient moins rompues à la rédaction d’un dossier de candidature ainsi qu’à la modélisation du retour sur investissement (ROI) de leur projet ». Par ailleurs, « le financement par délégation de gestion (…) prive la DITP d’une maîtrise sur la prévision et la consommation des crédits dont elle est responsable », le secrétariat général du FTAP devant recueillir les informations de suivi du financement et des économies réalisées dans le cadre de l’annualité budgétaire auprès des ministères dépensiers eux-mêmes. |
Un pilotage budgétaire très complexe, obscurcissant le suivi des fonds
Comme le relève les magistrats de la rue Cambon, « le fait que des ministères, au cœur des politiques prioritaires, soient faiblement représentés, voire absents, des projets soutenus par le FTAP, montre que sa gouvernance d’ensemble n’a pas été politiquement pilotée (…). Il en a découlé pour partie une logique de guichet, donnant des avantages aux administrations puissantes (…) porteuses de projets structurés ». Ainsi par exemple le ministère des finances a pu proposer près de 30 projets pour un montant de 230 M€, soit 29 % des engagements du FTAP.
A cette dérive d’affectation des crédits liée au principe même de l’AAP et de l’absence de ciblage initial de l’enveloppe du FTAP s’est ajoutée celle du pilotage opérationnel du FTAP lui-même, qui a été écartelé entre des équipes faibles numériquement, 3 puis 5 ETP issus de la DITP. Le portage politique était en apparence « fort » puisque le CITP présidé par le Premier ministre a décidé de confier la gestion du FTAP à un comité de pilotage présidé par le ministre en charge de la réforme de l’Etat… En réalité « le pilotage opérationnel du fonds interministériel (…) a échappé à une gouvernance de haut niveau ». En effet, « les deux derniers CITP de septembre 2023 et d’avril 2024 ne mentionnent plus le fonds » qui ne sélectionne d’ailleurs plus de nouveaux projets en 2024 et dont l’extinction devrait être prononcée en 2025. Par ailleurs sur le plan opérationnel, jusqu’en 2021, la gestion budgétaire du fonds était réalisée par la direction du budget alors que le pilotage opérationnel (dont la sélection des projets) revenait à la DITP. A compter de 2021 la DITP a alors reçu « la pleine responsabilité du fonds » mais « a été à l’origine de retards très importants dans l’exécution budgétaire du fonds, indépendamment des effets de la crise sanitaire ».
La rédaction d’un nouveau cahier des charges en 2023 et une révision drastique des critères de sélection a mis fin aux AAP pour s’orienter vers une sélection au fil de l’eau des dossiers les plus intéressants (signature du contrat de transformation dans un délai de 1 mois après sélection et engagement des dépenses sous 6 mois après la signature des contrats sous peine d’annulation). Enfin il a été précisé que l’ensemble des crédits devraient être consommé d’ici la fin 2025 sans possibilité de reports.
Ces perturbations ont cependant abouti à un grave défaut de cohérence entre inscriptions budgétaires et exécution réelle des fonds, aboutissant à un niveau d’exécution du FTAP fin 2024 très inférieur aux enveloppes annoncées. La Chronique suivante peut en être donnée :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total 18-24 | ||
LFI | AE | 200 | 245 | 200 | 40 | 80 | 241,5 | 123,01 | 1129,53 |
| CP | 0 | 160 | 205,61 | 148,74 | 168,74 | 190,3 | 140,37 | 1013,76 | |
Crédits ouverts | AE | 200 | 419,85 | 544,54 | 427,81 | 141,08 | 210,56 | 133,77 | 2079,82 |
| CP | 0 | 78,26 | 75,98 | 147,96 | 142,88 | 190,14 | 147,22 | 786,7 | |
Crédits ouverts retraités des reports | AE | 200 | 240 | 190,02 | 35,17 | -116,63 | 204,56 | 45,82 | 798,92 |
| CP | 0 | 78,26 | 75,96 | 143,91 | 135,12 | 184,14 | 121,84 | 739,23 | |
Exécution FTAP | AE | 20,15 | 65,33 | 151,94 | 167 | 114,24 | 105,5 | 89,2 | 713,36 |
| CP | 0 | 37,6 | 71,9 | 133,92 | 135,18 | 155,62 | 152,68 | 686,9 |
Source : Rapport Cour des comptes, novembre 2025.
Ainsi le fonds annonce un niveau de consommation de 687 M€ entre 2018 et 2024, bien éloigné du montant total de CP ouverts en loi de finances initiales (1,01 Md€) ou exprimés en AE (autorisations d’engagement) soit 1,1 Md€.
Il en résulte que les consommations résiduelles à fournir par rapport aux enveloppes budgétisées sont encore très importantes.
Montants (AE=CP en M€) alloués par appel à projet (AAP) puis comité | Taux de consommation des crédits de paiements (CP) à fin: | ||||||||
2023 (réalisé) | 2023 (réalisé) | 2024 (réalisé) | 2024 (réalisé) | 2025 (prévisionnel) | 2025 (prévisionnel) | 2026 (prévisionnel) | 2026 (prévisionnel) | ||
| AAP 1 (2018) | 97,6 | 88% | 85,9 | 97% | 94,67 | ||||
| AAP 2 (2018) | 68,3 | 82% | 56,0 | 88% | 60,10 | ||||
| AAP 3-1 (2019) | 67,3 | 84% | 56,5 | 87% | 58,55 | ||||
| AAP 3-2 (2019) | 87,3 | 61% | 53,3 | 93% | 81,19 | ||||
| AAP 4-1 (2020) | 139,6 | 71% | 99,1 | 78% | 108,89 | 99,97% | 139,56 | 100% | 139,6 |
| AAP 4-2 (2020) | 110,3 | 75% | 82,7 | 83% | 91,55 | 100% | 110,30 | ||
| AAP 5-1 (2021) | 51,2 | 66% | 33,8 | 92% | 47,10 | 95% | 48,64 | ||
| AAP 5-2 (2021) | 27,9 | 45% | 12,6 | 73% | 20,37 | 81% | 22,60 | ||
| AAP 6-1 (2022) | 89,1 | 24% | 21,4 | 45% | 40,10 | 66% | 58,81 | 100% | 89,1 |
| 7-1 (7/2/2023) | 30,8 | 1% | 0,3 | 27% | 8,32 | 100% | 30,80 | ||
| 7-2 (17/3/2023) | 9,5 | 21% | 2,0 | 52% | 4,94 | 100% | 9,50 | ||
| 7-3 (21/4/2023) | 0,6 | 25% | 0,2 | 100% | 0,60 | ||||
| 7-4 (23/05/2023) | 0 | ||||||||
| 7-5 (4/7/2023) | 32 | 3% | 1,0 | 39% | 12,48 | 74% | 23,68 | 100% | 32 |
| 7-6 (20/7/2023) | 8 | 12% | 1,0 | 71% | 5,68 | 96% | 7,68 | 100% | 8 |
| 7-7 (10/11/2023) | 8,6 | 51% | 4,39 | 94% | 8,08 | 100% | 8,6 | ||
Enveloppe déconcentrée (OTE, convergence puis FTAP déconcentré) | 35 | 81% | 28,4 | 86% | 30,10 | 87% | 30,45 | ||
Total (montant par année, taux de consommation cumulé total en %) | 862,02 | 62% | 534,0 | 78% | 669,0 | 91,1% | 490,1 | 93,7% | 277,3 |
Source : DITP
Le niveau final de consommation anticipé par la DITP ressort à 862 M€ soit un niveau très supérieur aux 687 M€ de fin 2024, même augmenté de 100 M€ (soit 790 M€) anticipé pour la fin 2025. Ils devraient s’étendre en définitive également sur l’exercice 2026. La Direction du Budget estime que la consommation finale ne devrait pas dépasser les 820 M€ et la Cour « à un niveau inférieur à 800 M€ d’autant que des arbitrages budgétaires peuvent affecter la capacité de cofinancement des porteurs de projets ».
Le SGG fait par ailleurs remarquer que « la suppression des reports [de crédits ndlr] (…) devait se traduire par une budgétisation d’AE et de CP de « services votés » chaque année en plus des crédits nécessaires aux projets nouveaux du FTAP2. Mais cette méthode s’est avérée insoutenable (…) compte tenu des ressauts de CP à afficher en loi de finances. Le FTAP a dû piloter les projets non plus par des AE mais par les CP mis à sa disposition, ce qui est encore plus complexe ». En réalité, les services ont préféré ne pas « sincériser » la présentation du FTAP de peur de coupes de crédits à l’occasion des discussions budgétaires devant le Parlement.
Des économies très en-deçà des prévisions initialement escomptées
Les économies annoncées par les porteurs de projets résultaient de données totalement déclaratives. Il ne s’agissait donc pas de calculs partagés avec les équipes de la DITP selon une méthodologie et une présentation standardisée. Ainsi comme le relève le SGG « les seuls projets pour lesquels la DITP est pleinement confiante sur les gains de productivité générés sont les missions opérationnelles, qu’elle supervise directement (…) très souvent avec des taux de retour bien supérieurs au mandat du FTAP ».
En revanche et conséquence de l’auto-déclaration des économies par les porteurs de projets eux-mêmes sans expertise extérieure, « les ministères sont incités, en phase de candidature, à majorer les économies attendues, afin d’augmenter leurs chances d’obtenir un financement du FTAP » et à l’inverse « sont plutôt susceptibles de les minorer en fin de projet, pour éviter que les moyens correspondants ne leur soient retirés durant la procédure budgétaire ».
Les économies sont donc à géométrie variable faute d’audit extérieur systématique et homogène.
| En M€ | Coût total des projets | FTAP CP exécuté au 31/12/2024 (A) | Economies attendues (B) | Economies révisées (C) | Economies pérennes déclarées (D) | ROI attendu (B/A) | ROI révisé (C/A) | ROI déclaré (D/A) |
| Total des projets FTAP | 1 937 | 687 | 2 072 | 1 036 | 339 | 3,0 | 1,5 | 0,5 |
Source : Cour des comptes, novembre 2025.
En conséquence, les économies pérennes déclarées sont sans doute « minorées » par les ministères dépensiers afin de conserver leurs enveloppes budgétaires – masquant les gains de productivité réels obtenus – quitte à déployer des crédits pour de nouveaux besoins. Il en résulte que le ROI (retour sur investissement) est très loin des niveaux escomptés initialement (6 fois moins important). S’il existe un hiatus entre les estimations des économies directes attendues (économies révisées) de 990 M€ contre 1,036 Md€ pour la Cour des comptes, la 1ère évaluation correspondrait à un gain de productivité de 5.162 ETP. Les économies pérennes affichées ne représenteraient plus qu’un gain de 1.768 ETP.
Cependant comme le relève la Cour, « le respect du ROI est néanmoins en grande partie d’apparence pour de multiples raisons :
les montants affichés sont artificiels,
les modes de calcul sont confus,
la base tant des montants prévisionnels que réalisés est déclarative,
la capacité de la DITP à auditer les déclarations est très faible malgré le système de suivi mis en place ».
Par ailleurs « la direction du budget (…) n’est pas au niveau de granularité suffisant pour appréhender les économies potentielles et en tirer des conclusions sur la base des crédits alloués ».
Sur ce dernier point, la Cour souligne que « la DITP ne dispose pas de tels moyens, sauf à mobiliser les consultants de son agence de conseil interne ». Il faudrait, suggère la Cour, mobiliser les inspections générales des ministères bénéficiaires comme pour les revues de dépenses.
Pour la mise en place d’une « task force » d’inspection permanenteLa mise en place d’une inspection générale unique, sur la base du Somushô japonais[1] n’a jamais vu le jour en France, chaque ministère cherchant malgré la suppression des corps d’inspection conserver un outil ad hoc. Il en résulte la mise en place suivant les arbitrages politiques de missions d’inspections conjointes, sans vision d’ensemble. L’identification des économies réalisées dans le cadre du financement de projets de modernisation et de transformation de l’action publique mériterait au contraire la mise en place d’une « task force » unique d’audit et d’évaluation regroupant les compétences des principaux corps généraux d’inspections et des inspections sectorielles en tant que de besoin, afin d’auditer de façon harmonisée les économies réalisées, les gains de productivité dégagés et les retours sur investissement réalisés. |
Conclusion
Faute d’orientation des programmes de modernisation dans le droit fil des recommandations du rapport CAP 2022 et en l’absence de nouvelles revues de dépenses (arrêtées en 2017, puis reprises ensuite courant 2023[2]), et en l’absence d’une articulation étroite entre les orientations du CITP déclinées en 60 PPG (politiques prioritaires du Gouvernement) et le cofinancement du FTAP, celui-ci en est resté largement jusqu’en 2023 à faire remonter les dossiers de modernisation sur étagères des ministères les plus à même de produire des projets clés en main. L’absence d’audit contradictoire systématique des économies documentées par ces mêmes projets n’a pas permis d’atteindre le niveau de ROI désiré initialement, ratant largement l’objectif d’1€ d’économie pour 1€ investi sur trois ans. On relève essentiellement 5 impasses qu’il faudrait ne pas reproduire :
S’appuyer uniquement sur des évaluations déclaratives des porteurs de projet dans le cadre d’appels à projet ;
Emietter les enveloppes au point d’aboutir à financer des dépenses courantes et non structurantes de certaines administration ;
Sous-dimensionner le secrétariat en charge de l’instruction et du suivi des investissements ;
Architecturer le financement par délégation de gestion, ce qui pose la question de la granularité du reporting et des réorientations en cours de déploiement ;
Budgétiser de façon trop précise les investissements, limitant leur fongibilité et leur redéploiement éventuel, ce qui complexifie le suivi budgétaire ;
Il faut donc tout au contraire, créer un secrétariat robuste capable de s’appuyer en tant que de besoin sur une task force d’audit opérationnelle (économie, ROI). Mises sur les projets les plus structurants en évitant tout émiettement trop poussé, permettant un pilotage lisible et une focalisation des moyens sur les projets à forts enjeux.
[1] Voir notre note sur le rapport Thieriez en date du 20 février 2020, https://www.ifrap.org/fonction-publique-et-administration/ena-rapport-thiriez-les-bons-et-les-mauvais-points, ainsi que sa note de bas de page n°2 que nous reproduisons in extenso : S’agissant du service d’inspection du Somushô, Jean-Luc Pissaloux , Les inspections générales au sein de l’administration française : structures, fonctions et évolution in Revue française d'administration publique 2015/3 (N° 155), pages 601 à 622 en particulier la note 47. Voir également nos notes antérieures sur le sujet, https://www.ifrap.org/fonction-publique-et-administration/baisser-le-nombre-de-corps-de-la-fonction-publique . Par ailleurs le rapport fait l'impasse sur le CGefi proposé par le rapport du sénateur Collombat, http://www.senat.fr/rap/r18-016-2/r18-016-21.pdf.
[2] François Ecalle, les revues de dépenses, 11/04/2024 https://www.fipeco.fr/commentaire/Les%20revues%20des%20d%C3%A9penses%20publiques