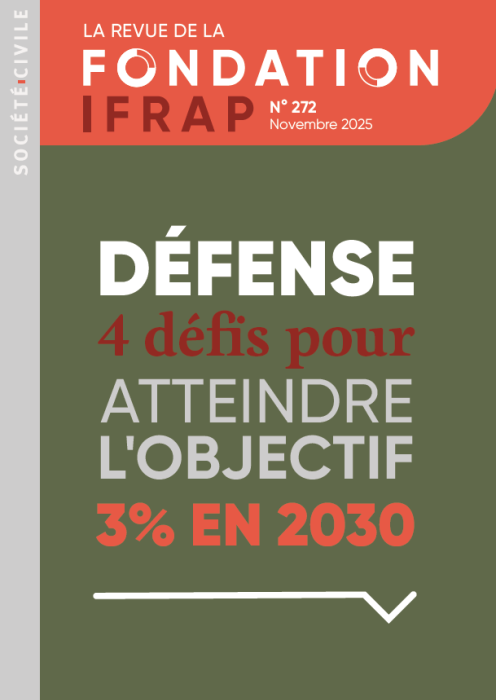Accord bilatéral franco-algérien de 1968 : les enseignements d'un rapport parlementaire
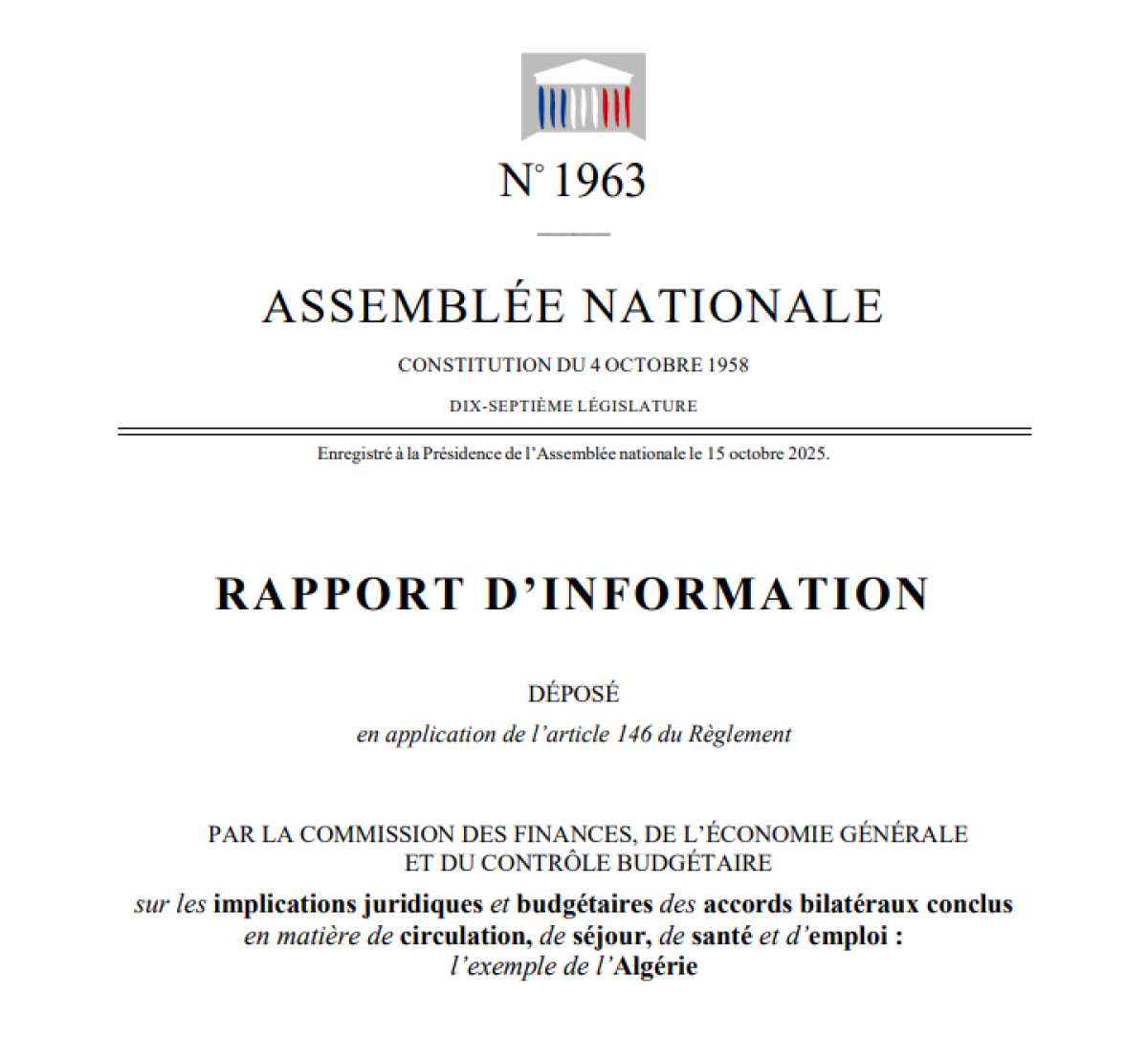
Dans un récent rapport "sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus en matière de circulation, de séjour, de santé et d’emploi", les députés Ensemble pour la République Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre (devenu ministre délégué chargés de la Transition écologique du Gouvernement Lecornu 2) s’interrogent sur le statut juridique de séjour, de circulation et d’accès à la sécurité sociale des ressortissants algériens en France, régis par « l’accord franco-algérien de 1968 » (accord du 27 décembre 1968 et son protocole annexe signé à Alger le 22 décembre 1985). Les rapporteurs soulignent plusieurs situations exorbitantes du droit commun et font des propositions.
Les principaux instruments juridiques de la relation franco-algérienne en matière de circulation, de séjour et de droits sociaux Les conditions de séjour et de circulation des personnes de nationalité algérienne sont régies par un accord entre la France et l’Algérie du 27 décembre 1968, qui a fait l’objet de trois avenants en 1985, 1994 et 2001. Il a par ailleurs été complété par quatre accords bilatéraux : celui du 31 août 1983, traitant de l’exemption réciproque de visas, l’accord relatif aux échanges de jeunes actifs du 26 octobre 2015, l’accord du 16 décembre 2013 sur l’exemption réciproque de visas de court séjour, et un procès-verbal confidentiel de 1994 relatif aux laissez-passer consulaires. Et plus récemment l’accord d’association UE-Algérie d’avril 2002. S’agissant des droits sociaux garantis par la sécurité sociale française, ils bénéficient d’une interprétation anachronique des accords d’Evian du 19 mars 1962[1], de la jurisprudence du Conseil d’Etat notamment s’agissant du RSA et du minimum vieillesse (ASPA), mais aussi s’agissant des prestations de santé à travers la convention générale de sécurité sociale 1er octobre 1980, son protocole annexe entre la CNAM et la CNAS algérienne remplacé par celui du 10 avril 2016 et l’accord d’association UE-Algérie en matière de droit des prestations familiales. |
Des droits de séjour et de circulation spécifiques
Tout d’abord, d'un point de vue pratique, la primo-délivrance des titres de séjour est gratuite pour les Algériens depuis l’avenant de 2001 à l’accord franco-algérien de 1968. Le droit commun impose aux étrangers des pays non-européens une somme de 225 euros.
Sur le plan conventionnel, dès 1976, l’accord franco-algérien devient plus favorable que le droit commun des étrangers qui tend, lui, à se durcir. En effet, le gouvernement français, au travers du décret du 29 avril 1976, met en place le droit au regroupement familial. Il peut être refusé pour quatre motifs : durée de résidence du chef de famille trop courte, insuffisance des ressources, inadaptation des conditions de logement et nécessités d’ordre public. L’accord franco-algérien se caractérise lui par l’absence de conditions de ressources, l’absence de mention de la durée de résidence en France, et l’absence de réserves explicites tenant à des questions d’ordre public.
Par ailleurs, les différents avenants intervenus (1985, 1994 et 2001) ont contribué à écarter encore davantage du droit commun le statut des ces immigrés :
L’avenant du 22 décembre 1985 a abrogé le contingentement annuel, c'est à dire la limitation du nombre de travailleurs algériens.
L’avenant du 28 septembre 1994 a étendu à trois années au lieu de six mois la durée de résidence hors du territoire national pour la péremption du certificat de résidence.
L’avenant de juillet 2001 supprime quant à lui le contrôle des moyens d’existence.
La jurisprudence a par ailleurs contribué à consolider cette exorbitance. Tout d’abord, l’accord franco-algérien de 1968 ne prévoit pas effectivement l’application de la législation nationale sur les points qu’il n’aborde pas… Si bien que l’analyse du Conseil d’Etat « fait obstacle à ce que les réformes du droit [commun] des étrangers (…) soient applicables aux ressortissants algériens ». Il en a résulté la constitution d’une interprétation asymétrique du droit qui leur est applicable suivant un principe général de faveur : « la jurisprudence administrative a (…) régulièrement interprété cette convention en attrayant certaines dispositions favorables du droit commun dans le champ du droit applicable aux Algériens d’une part, et en interprétant au contraire strictement certaines mesures défavorables d’autre part. »
Ainsi, le Conseil d’Etat estime qu'« aucun texte ne s’oppose à une mesure de régularisation en faveur d’un Algérien qui ne satisfait pas à l’accord du 27 décembre 1968 », laissant au pouvoir discrétionnaire du préfet le choix de statuer… Ce qui revient à appliquer l’admission exceptionnelle au séjour du droit commun[6] alors qu’elle ne figure pas dans l’accord de 1968.
S’agissant au contraire du retrait des certificats de résidence, la jurisprudence stipule que « l’administration ne peut jamais retirer de titre de séjour à un ressortissant algérien dès lors que cette possibilité n’est pas explicitement prévue à l’accord ». Or, l’accord n’aborde jamais cette question depuis le retrait du critère d’oisiveté par l’avenant de 1994.
Idem pour les motifs d’ordre public : le titre de séjour d’un ressortissant « dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ne peut pas être retiré ». Le refus de renouvellement d’un titre de séjour pour menace à l’ordre public est de la même façon impossible pour les titres valables dix ans car l’accord prévoit que leur renouvellement est automatique.
Les Algériens détenteurs d’un titre de séjour ne peuvent se le voir retiré, même pour l’étranger passible de condamnations prévues par l’article L. 432-6 du Ceseda, à savoir trafic de stupéfiant, esclavage et traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, conditions de travail indignes, ainsi que certaines formes aggravées de vol, d’extorsion et de recel.
Enfin, les possibilités de retrait du titre de séjour par le Ceseda pour des faits de polygamie, d’irrespect de la procédure de regroupement familial ne sont pas opposables à ces ressortissants.
Leur entrée sur le territoire nationale est facilitée. Ainsi, les certificats d’un an « vie privée et familiale » ne sont pas subordonnés à des conditions d’entrée régulière sur le territoire national (notamment relevant de l’article 6 de l’accord), ce qui revient à une dispense de visa. Par ailleurs, l’article 6.1 prévoit la délivrance d’un certificat de résidence au bout de dix ans de résidence habituelle en France (quinze si séjour étudiant), et n’impose pas que ce séjour fut régulier… ce qui constitue un véritable droit à la régularisation[7]. S’agissant des conjoints de Français, l’exigence de communauté de vie effective n’est demandée qu’à l’occasion du renouvellement du titre de séjour et non dès le début du mariage, contrairement au droit commun. De plus, au bout d’un an de mariage sur le sol français, un titre de séjour de dix ans est accordé de plein droit. Pour les conjoints de scientifiques, aucun visa de long séjour n’est nécessaire pour prétendre au certificat de résidence.
D’autre part, le regroupement familial est encouragé : les personnes regroupées reçoivent des titres de séjour de même durée que la personne qu’ils rejoignent (contrairement au droit commun), la condition de ressource est évaluée au Smic mais si les APL sont exclus de ce calcul, le RSA, l’ASPA (minimum vieillesse), l’ASS ou l’AER (allocation équivalent retraite) sont inclus dans le panier de ressources du demandeur, contrairement au droit commun. Ils peuvent en outre demander le regroupement familial dès douze mois en France (contre 18 mois pour le droit commun), et l’avis du maire pour l’enquête logement n’est pas sollicité. Enfin, le retrait du certificat de résidence dans les deux ans qui suivent sa délivrance ne peut s’appuyer ni sur la polygamie, ni sur la rupture de la vie commune, ni sur le non-respect des valeurs de la République, ni sur trouble à l’ordre public. Ainsi « le préfet n’est pas fondé à retenir la circonstance que [le demandeur] constitue une menace à l’ordre public » pour rejeter les demandes de regroupement familial « dès lors qu’un tel motif n’est pas applicable au cas de ressortissants Algériens ». Le regroupement familial hors cas de fraudes avérées devient ainsi de facto un droit opposable à l’administration française.
Le certificat de résidence portant mention « commerçant » L’article 5 de l’accord franco-algérien permet en outre une voie migratoire spécifique pour les activités professionnelles non salariées. L’accord « ne prévoit pas d’autre condition que celle de l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ». Ainsi, au sein du RCS, on dénombre 105 590 personnes physiques de nationalité algérienne, soit 18 % de l’ensemble des personnes algériennes qui résident en France. On trouve en premier lieu des activités de coursiers (17 374 sociétés actives), les locations de fonds de commerce (5 360 sociétés), 5 087 sociétés de nettoyage courant des bâtiments. On relèvera par ailleurs que les visas « étudiants » qui sont accordés à des ressortissants algériens peuvent les conduire à se maintenir sur le territoire national même après abandon de leurs études en basculant sur le « visa entrepreneur ». |
Comme nous l’avons montré plus haut, les refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait des titres de séjour sont beaucoup plus difficiles que pour les étrangers d'autres nationalités. Mais surtout, « l’accord franco-algérien ne prévoit aucune stipulation permettant le retrait d’un certificat de résidence algérien (CRA) en cours de validité ». Par exemple, ceux qui souhaitent résider sur notre territoire ne sont soumis à aucune vérification d’une connaissance minimale de la langue française, ni à la signature du contrat d’intégration républicaine. Si cette signature est toutefois proposée par le préfet, « cette interprétation de l’administration nécessitera de passer au filtre du contrôle du juge administratif, qui, pour l’heure, s’est toujours montré très fermé sur cette question du retrait ».
A ces circonstances de droit (jurisprudentielles et conventionnelles) s’ajoute que l'accord, « outre le fait qu’il n’impose aucune obligation à la partie algérienne, ne porte pas sur le volet réadmission ». Pour autant, un protocole en matière de délivrance des laissez-passer consulaires a été conclu en 1994 sous la forme d’un « procès-verbal » non public mais interprété par une circulaire du 18 juillet 1994. A cette fin, un comité d’experts franco-algérien devait se réunir périodiquement afin de garantir la bonne application de ce protocole d’accord sur les réadmissions. Mais « les relations avec les autorités consulaires algériennes n’ont jamais permis d’obtenir des taux satisfaisants d’exécution des décisions d’expulsion ».
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (4 mois) | |
Mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de ressortissants présumés algériens | 10 245 | 13 911 | 15 828 | 16 238 | 21 452 | 27 645 | 25 797 | 22 426 | 9 055 |
Mesures d'éloignement exécutées de manière forcée (Algériens) | 1 015 | 1 268 | 1 650 | 388 | 34 | 987 | 1 680 | 1 719 | 414 |
Mesures d'éloignement exécutées de manière aidée (Algériens) | 59 | 76 | 84 | 22 | 62 | 242 | 149 | 383 | 182 |
| Nombre de LPC demandés | 1 943 | 2 814 | 3 180 | 2 038 | 2 111 | 4 043 | 5 465 | 5 350 | 1 939 |
Nombre de LPC délivrés dans les délais utiles | 684 | 907 | 1 142 | 315 | 54 | 962 | 1 114 | 1 121 | 287 |
Nombre d'éloignements forcés exécutés par rapport au nombre de mesures d'éloignement prononcées | 6,7% | 6,5% | 7,2% | 1,9% | 0,3% | 3,5% | 4,3% | 5,0% | 3,2% |
Source : ministère de l’Intérieur (mission).
On relèvera qu’entre 2017 et 2024, le nombre de mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de ressortissants algériens a augmenté de 118,9 %, tandis que le nombre de laissez-passer consulaires délivrés a augmenté de 63,9 %. Il en résulte que le nombre d’éloignements forcés exécutés par rapport au nombre d’éloignements prononcés a baissé de 1,7 point pour atteindre 5 % seulement en 2024, contre 6,7 % en 2017. Il existe par ailleurs un net ralentissement depuis mars 2025, puisqu’à cette date l’Algérie a cessé toute coopération avec la France en cessant ses auditions consulaires. En effet, au 1er octobre 2025, on enregistrait les éloignements forcés de 486 Algériens, soit -63 % par rapport à la même période en 2024.
Par ailleurs, plusieurs attitudes bloquantes sont également évoquées :
L’Algérie interdit le versement des pécules pour l’aide au retour via les agences Western Union, et oblige à ce que « les pécules [soient] données en liquide avant les départs ». « Cette restriction empêche l’OFII de mettre en œuvre les aides au retour » à partir des CRA (Centres de rétention administratifs).
Dans le cadre des visas-réadmissions et des accords de réadmission (notamment UE-Algérie), l’Algérie (comme le Maroc) n’accepte pas les vols charters et préfère les accords bilatéraux. L'Algérie exige parfois que le retour d’une personne soit effectué dans les 24 heures qui suivent la délivrance des documents de voyage, ce qui est matériellement impossible.
Enfin, l’Algérie est le pays qui génère le plus de recours administratifs préalables obligatoires devant la commission de recours des refus de visa d’entrée, soit 24 % en 2024.
Un statut privilégié en matière de protection sociale
En droit de la protection sociale, le principe en droit commun est l’égalité de traitement entre les résidents étrangers et les ressortissants français. Le principe constitutionnel d’égalité a été reconnu aux étrangers en matière de protection sociale par le Conseil constitutionnel le 22 janvier 1990, puis par la loi du 11 mai 1998 qui a supprimé les principales différences de traitement. Mais des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer :
La régularité du séjour sur le territoire national (hors bénéfice de l’AME) ;
Une condition de durée de résidence pour certaines prestations sociales ;
Or, dans quatre domaines, les Algériens bénéficient d’une situation plus favorable que les autres ressortissants étrangers :
Tout d’abord en matière de minima sociaux (RSA, PA, ASPA (allocation de solidarité des personnes âgées)) ;
Ensuite, des conventions bilatérales signées en matière de sécurité sociale leur offrent le bénéfice de « soins programmés » en France ;
L’accord d’association UE-Algérie a également été interprété de façon à leur accorder des droits importants et dérogatoires en matière d’allocations familiales ;
Enfin, l’accord franco-algérien de 1968 ouvre des voies dérogatoires d’accès à un titre de séjour pour raisons médicales.
En matière de minima sociaux, alors que pour le RSA et l’ASPA leur bénéfice était subordonné à la possession d’un titre autorisant à travailler cinq ans pour le RSA et 10 ans pour l’ASPA, le Conseil d’Etat a décidé par un arrêt du 9 novembre 2007[8] que « les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français ». Le Conseil d’Etat écarte donc pour eux la condition préalable de la durée de résidence[9], avec un double effet puisque le RSA est inclus pourcette proportion d'étrangers uniquement dans le calcul de la condition de ressource pour le regroupement familial. Il en va de même pour l’ASPA (minimum vieillesse) pour laquelle la condition de résidence de dix ans a elle aussi été supprimée[10]. Les rapporteurs du rapport de l'Assemblée nationale en déduisent que cette condition de durée de résidence préalable doit également être supprimée s’agissant de la prime d’activité (PA). Elle est en tout cas plus favorable que pour les autres ressortissants européens qui, ne devant pas « devenir une charge pour le système d’assistance sociale (…) n’(ont) pas le droit au revenu de solidarité active » (article L.262-6 du Ceseda).
En second lieu, ils bénéficient des accords de sécurité sociale conclus entre la France et l’Algérie, et plus particulièrement la convention générale de sécurité sociale conclue le 1er octobre 1980 et son arrangement administratif du 28 octobre 1981. Ils instaurent notamment que « les prestations maladie sont servies par l’institution de l’Etat de résidence mais l’institution de l’autre Etat y contribue pour moitié sur la base d’un montant forfaitaire ». Il en résulte une dette publique croisée, dont une créance estimée à 102,5M € de la France vers l’Algérie entre 2018 et 2024, et symétriquement de l’Algérie vers la France de 430M € sur la même période.
A cela s’ajoute le protocole de 2016 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens. Or, à défaut d’une autorisation préalable de la CNAS[11] algérienne, le CNE (Centre national des soins à l’étranger) français ne peut pas refacturer le montant de ces soins à la sécurité sociale algérienne. Le recouvrement de la créance sur personne bien souvent insolvable est de la compétence de l’hôpital français, ce qui génère également une importante dette privée « qu’il est pratiquement impossible de recouvrer ». Les soins programmés depuis l’Algérie viennent alors nourrir le déficit de l’hôpital public en France.
Mais il ne s’agit pas de la seule voie d’entrée pour raison médicale, puisqu’il existe aussi au titre de l’article 6.7 de l’accord de 1968 un titre de séjour « Algérien-malade », auquel la jurisprudence a étendu (principe de faveur) la réforme du 7 mars 2016 permettant « de prendre en compte les capacités notamment financières de l’intéressé ou les mécanismes de protection sociale du pays d’origine, au-delà de l’existence objective des traitements ».
En matière de retraites, un différend d’interprétation oppose la France et l’Algérie depuis près de 40 ans. La législation nationale algérienne pose un principe de territorialité des prestations de sécurité sociale qui l’empêcherait de servir leurs pensions aux retraités algériens et binationaux résidant sur le territoire français et relevant pourtant du régime de retraite algérien. En conséquence de quoi « la France fait malgré tout droit aux demandes d’allocation de substitution qui émanent de travailleurs pourtant pensionnés algériens » et leur octroi le bénéfice de l’ASPA. Cela représente près de 361 771 pensions versées en 2023 (138 638 pensions de vieillesse et 223 133 pensions de réversions) pour un montant total de près d’un milliard d’euros.
Enfin, l’interprétation de l’accord d’association UE-Algérie en matière de droit aux prestations familiales est elle aussi un facilitateur : en vertu du droit existant, les étrangers bénéficient de plein droit des prestations familiales sous réserve de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. En pratique, les CAF subordonnent le droit aux prestations à la production d’un certificat médical produit par l’OFII. Mais cette formalité substantielle n’est pas applicable pour eux. En effet, la Cour de cassation le 5 avril 2013[12] a toutefois décidé que « les prestations familiales pour les enfants entrés irrégulièrement sur le territoire ne pouvaient être refusées aux Algériens », en s’appuyant sur l’article 68 de l’accord d’association[13]. Cette position a encore été étendue par la CJUE, décision du 19 décembre 2024, en jugeant que « l’exclusion du droit aux prestations familiales pour les enfants entrés hors regroupement familial [était] contraire à la directive « Permis Unique »». [14]
En application du Préambule de 1946, « les seules limitations admissibles des droits économiques et sociaux sont celles touchant les étrangers en situation irrégulière ». On peut alors s’interroger sur les différences d’accès aux prestations sociales lorsqu’elles sont prévues par certaines conventions internationales. En la matière, il est de principe constant que les normes constitutionnelles l’emportent sur les normes internationales – raison pour laquelle il est parfois nécessaire de modifier la Constitution afin de permettre au Parlement de pouvoir ratifier un accord international qui sinon leur serait contraire.
Deux décisions constitutionnelles viennent ainsi appuyer la suppression de toute différence de traitement entre les étrangers en matière d’accès et de séjour sur le territoire national, et au bénéfice du système de protection sociale.
La décision du CC du 22 janvier 1990 par laquelle il affirme que le principe d’égalité interdit de réserver certains droits aux seuls étrangers pouvant se prévaloir de conventions internationales ;
La décision du CC du 13 août 1993 portant la loi relative à la maîtrise de l’immigration, où le Conseil a admis en creux qu’une disposition qui ne serait pas de nature constitutionnelle « ne peut fonder de discrimination entre étrangers, surtout lorsqu’elles sont générales ».
Les propositions du rapport parlementaire
Le rapport parlementaire souligne ainsi qu’il « n’est pas certain que le caractère général des dérogations qui s’appliquent aux Algériens soit conforme aux exigences constitutionnelles actuelles ». Mais en l’état actuel du droit, le contrôle de constitutionnalité a posteriori des traités internationaux n’existe pas. En effet, « le rapporteur n’a pas connaissance de recours introduits par des ressortissants d’Etats tiers qui s’estimeraient victimes d’une rupture d’égalité ». En l’absence de recours des intéressés, il appartient au Gouvernement de tirer lui-même les conséquences des torsions de l’ordre juridique induits par les accords signés par la France avec l’Algérie en la matière, de l’absence de contrepartie offerte par la partie algérienne s’agissant des accords d’accueil et de séjour, de l’absence ou de l’inefficacité des mécanismes de réadmission, et des différents non soldés s’agissant des accords en matière de sécurité sociale.
L’accord de 1968 ne comportant aucune disposition de la partie algérienne, ni aucune clause de réciprocité, il s’apparente à une déclaration unilatérale de la France de fait. Dans ces conditions les auteurs du rapport pour la commission des finances proposent :
Soit de dénoncer les accords existants, dans la mesure où « cette décision s’apparenterait davantage à une rétractation pour changement de circonstances de droit qu’à une dénonciation, en l’absence de clause de réciprocité ou d’engagement de quelque nature que ce soit de la partie algérienne ».
Soit à défaut (mesure de repli), d’insérer dans le Ceseda (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) une disposition législative prévoyant que « de façon générale (…) le droit commun s’applique dans toutes les matières que les conventions internationales ne traitent pas ». Ce qui permettrait de soumettre à minima cette catégorie au même droit que les autres étrangers « en cas de non-respect des valeurs de la République (…) de menace à l’ordre public, de non-intégration à la société française ». Cela leur ouvrirait également l'accès à certains titres auxquels ils n’ont pas droit (carte pluriannuelle talent).
Enfin, insérer une clause d’ordre public relative à l’égalité de traitement de tous les étrangers s’agissant de l’ouverture des droits aux prestations sociales au sein du code de la Sécurité sociale.
Les chiffres de l'Insee
Les données statistiques ne sont pas parfaitement harmonisées. Cependant, il est possible de rapprocher avec prudence certaines d'entre elles. Pour l’Insee, en 2023, il y avait 587 200 personnes de nationalité algérienne en France, soit 0,8 % de la population française et 10,5 % des personnes de nationalité étrangère présentes sur le territoire national[2]. Si maintenant on considère la population immigrée algérienne en France, les résultats atteignent 892 000 personnes. On comptabilise dans cette catégorie uniquement les personnes nées étrangères à l’étranger (indépendamment de l’acquisition éventuelle ultérieure de la nationalité française). Ce chiffre exclut alors « les personnes nées en France mais ayant conservé la nationalité de leurs parents, avec ou sans binationalité »[3], qui sont comprises dans les 587 200 personnes de nationalités algérienne en France.
L’Insee montre par ailleurs qu’en 2023, sur 7,6 millions de personnes nées en France d’au moins un parent immigré (désignant ainsi les immigrés de 2ème génération), 1,238 millions étaient d’origine algérienne, soit 16,3 %. L’OID (Observatoire de l'immigration et de la démographie) dans une publication récente[4] a ainsi pu montrer qu’en y ajoutant les petits-enfants d’immigrés (3ème génération), la diaspora algérienne en France devait regrouper environ 2,7 millions de personnes. Les autorités algériennes avancent des chiffres plus élevés, entre 4 et 6 millions de personnes[5]. Il est donc raisonnable pour les rapporteurs du rapport de l'Assemblée nationale d’estimer que la diaspora algérienne au sens large représente entre 4,5 % et 6 % de la population française.
La croissance de cette diaspora a été d’ailleurs particulièrement rapide mais tend aujourd’hui à se stabiliser : après une multiplication par 10 entre 1946 et 1954 (passant de 22 000 individus à 210 000), celle-ci ne croît ensuite que de 66 % entre 1954 et 1962 (350 000). Dans les dix années suivantes, elle croît après la fin de la guerre d’Algérie de 65 % (720 000 en 1972), pour atteindre finalement 892 000 individus en 2023, soit une hausse de +24 %.
(Cette stabilisation doit cependant être comparée à la taille de la diaspora estimée, qui oscille donc entre 2,7 millions et 6 millions de personnes.)
Par ailleurs, comme l’indique l’étude de l’Insee d’août 2024, si cette population immigrée tend de se stabiliser, « la moitié des immigrés algériens vivant en France en 2023 sont arrivés en 2001 ou après ». Ainsi, la proportion des personnes de plus de 60 ans issues de l’immigration algérienne (18 % en 2018) augmente peu (+0,9 point entre 2008 et 2018), ce qui accrédite indirectement l’existence d’un flux régulier de nouveaux ressortissants entrant en France, compensant le vieillissement de la population résidente sur le territoire national.
[1] Notamment de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie.
[2] INSEE, Etrangers – Immigrés nés en 2023, paru le 27 juin 2024.
[3] INSEE, Première n°2010, 29 août 2024.
[4] OID, l’immigration des Algériens, mars 2025, https://observatoire-immigration.fr/l-immigration-des-algeriens/
[5] Déclaration du Président algérien Abdelmadjid Tebboune, entretien accordé à France 24, 4 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=bw4gjBmnDVk
[6] Articles L.435-1 et L.435-4 du CESEDA.
[7] Les rapporteurs font par ailleurs état de la suppression de ce dispositif du CESEDA depuis la loi du 24 juillet 2006 et depuis 2008 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 2008.
[8] CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 novembre 2007, n°279685. Voir https://www.ifrap.org/rsa-et-equivalents-europeens-quelles-conditions
[9] Rappelé par la circulaire CNAF n°2010-067 du 21 avril 2010 : « la condition d’antériorité de 5 ans de résidence est supprimée pour les ressortissants algériens (…) à la fois pour l’allocataire et son conjoint. »
[10] La circulaire de la CNAV du 19 novembre 2014 précise que « conformément aux engagements internationaux de la France, la condition de régularité du séjour préalable sur une durée déterminée (…) n’est pas opposable aux ressortissants algériens. »
[11] Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
[12] Cass, Ass. Plén. 5 avril 2013, 11-17.520.
[13] La circulaire de la CNAF du 5 juillet 2013 a précisé que tous les pays partis à un accord d’association euro-méditerranéen présentant de telles clauses étaient également dispensés de cette condition.
[14] Voir en particulier le dossier de la Fondation iFRAP, Exiger plus pour l’accès aux prestations sociales, Société civile n°268, juin 2025 https://www.ifrap.org/la-revue/exiger-plus-pour-lacces-aux-prestations-sociales