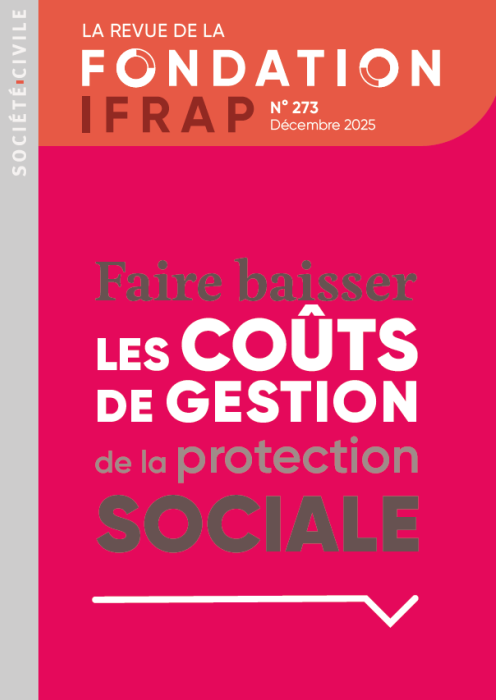Versement contemporain des APL : des risques de fraude nouveaux existent

Dans la touffeur de l’été, la commission des finances a publié un rapport d’information sur l’efficacité de la réforme du calcul des aides au logement et des dispositifs anti-fraude de la CNAF sous la plume du député François Jolivet. Et le tableau qui se dessine est clairement encore en demi-teinte. La réforme a été pensée pour générer des économies, mais pas pour simplifier les modes de calcul existants. Résultat, certaines informations doivent désormais être déclarées par le bénéficiaire alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant… augmentant les risques de fraude. Cela montre qu’il est important de penser l’ajustement des prestations au plus près de la situation des contribuables parallèlement à la simplification de ces dispositifs… des points aveugles qui pourraient être traités à l’avenir dans le cadre de la discussion du futur projet de loi de lutte contre la fraude sociale présenté par Catherine Vautrin début août. On se rappelle que ce vecteur serait essentiel pour atteindre un objectif de +2,3 Md€ en 2026 tiré de la lutte contre la fraude. Un objectif qui doit participer au plan d’ajustement budgétaire de 43,8 Md€ du Gouvernement.
Rendre le montant des APL contemporain, un objectif louable permettant d’économiser 1,1 Md€
Les APL bénéficiaient en 2023 à 5,87 millions de ménages (20% du total) pour un coût financier de 17 Md€ en 2024, soit 40% de la dépense publique consacrée au logement. Les aides aux logements sont en réalités multiples, on trouve en particulier l’APL, l’ALS et l’ALF. Ces trois aides participant à un ensemble plus grand encore constitué des aides au logement, à l’hébergement et à la propriété (comprenant notamment l’ASH (aide sociale à l’hébergement), les aides du fonds de solidarité logement (FSL) et l’aideau logement temporaire (ALT)). Pour chaque aide au logement une population spécifique est couverte :
- L’aide personnalisée au logement (APL) est destinée à toute personne résidant dans un logement conventionné ;
- L’allocation de logement à caractère familial (ALF) est destinée aux ménages ayant au moins un individu à charge (enfant, ascendant, ou proche parent infirme) ou les jeunes ménages n’entrant pas dans le champ d’application des APL (mesure balaie) ;
- L’allocation de logement à caractère social (ALS) étendue à toute personne disposant de faibles ressources et ne pouvant prétendre ni à l’APL ni à l’ALF… Elle concerne principalement les jeunes, les étudiants, et les ménages sans enfants non couverts par les deux premières allocations ;
Ventilation financière des APL en fonction du type de bénéficiaire
en M€ | Locatif ordinaire | Foyers | Accession | Total |
APL | 6 130 | 719 | 99 | 6 948 |
ALS | 4 878 | 398 | 60 | 5 336 |
ALF | 3 150 | <1 | 176 | 3 326 |
Total | 14 158 | 1 117 | 335 | 15 610 |
Source : rapport parlementaire op.cit. DREES
Enfin, le mode de financement de ces aides au logement a fait l’objet de simplifications successives. Sans entrer dans les détails, depuis 2016 le financement des aides au logement a été centralisé au sein du FNAL, et celui-ci était alimenté jusqu’en 2024 par une cotisation employeur versée par l’ACOSS et par une dotation budgétaire du programme 109. S’y ajoutaient des fractions de recettes fiscales (taxes sur les plus-values immobilières et les bureaux en Île-de-France) ou des contributions d’Action logement au titre de la PEEC. Depuis 2025 l’Etat a rebudgétisé la taxe sur les bureaux et la cotisation employeurs au FNAL pour un montant de 3 Md€. Désormais l’Etat finance intégralement les dépenses relatives aux aides personnelles au logement.
Des critères d’attribution complexes
Le mode de calcul des aides outre les critères d’entrée dans les différents dispositifs à raison des publics bénéficiaires cibles visés, repose sur deux critères principaux : les conditions de logement et les conditions de revenus :
|
La réforme de la contemporanésiation des aides personnelles au logement a été lancée le 1er janvier 2021. La Cour des comptes en janvier 2025 a pu montrer que le coût de déploiement de cette réforme avait été globalement maîtrisé [1], soit 106 M€ alors que les économies attendues ont été au rendez-vous, soit 1,1 Md€. La réforme de la contemporanéisation a permis ainsi de mettre fin à la désynchronisation de l’ouverture des droits et du versement de l’aide pour les bénéficiaires.
Auparavant, les ressources prises en compte dans le calcul des aides étaient celles perçues pendant l’année civile de référence soit l’année N-2 « compte tenu de la nécessité de prendre en compte en tout début de l’année N la totalité de la dernière année imposable connue. » Le dispositif était complété par un dispositif d’évaluation forfaitaire visant à prendre en compte des ressources très récentes, lorsqu’elles reflétaient des hausses de revenus. « Pour autant, la situation des allocataires ne faisait l’objet d’aucune correction, leur permettant de percevoir une aide régulière mais injustifiée, potentiellement pendant deux ans. »
Désormais grâce à l’exploitation de la DSN (déclaration sociale nominative), les ressources et les charges sont prises en compte tous les 3 mois grâce à plusieurs périodes de référence :
- Les revenus d’activité salariés via la DSN, du M-13 à M-2 (précédant l’ouverture des droits) ;
- Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle ou les frais professionnels, la période est celle de l’année N-1 ;
- Pour les autres revenus imposables (non-salariés, revenus du patrimoine) il s’agit toujours de l’année N-2 ;
Enfin tous les 9 mois, le réexamen de la situation des bénéficiaires est de droit et conditionné au dépôt d’une nouvelle demande. Enfin un dispositif de simplification est prévu avec des durées plus courtes lorsque le bénéficiaire perçoit également le RSA, la PA ou l’AAH. Dans ce cas « l’échéance trimestrielle du droit à l’aide au logement [peut être] (…) avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel des aides dont il bénéficie également. » Il y a donc une synchronisation des clauses de revoyure des aides entre elles.
Mais un dispositif pensé sans simplification et qui réintroduit du déclaratif :
En effet, l’exploitation de la DSN et des données PASRAU (pour les « revenus autres ») a permis d’exploiter le DRM (dispositif de ressources mensuelles) tenu par la CNAV qui a été mise à disposition des organismes payeurs. Ainsi la déclaration de ressources est désormais préremplie à partir des données du DRM, sans intervention du bénéficiaire. Cependant plusieurs types de revenus doivent toujours faire l’objet d’une déclaration ce qui constitue une trappe à fraude potentielle (ou au moins à erreurs) :
- Les revenus d’activité perçus à l’étranger, déclarés trimestriellement par l’allocataire ;
- Les pensions alimentaires, frais de tutelle et professionnels déclarés annuellement sur l’année de référence N-1 ; On aurait pu penser qu’avec l’agence de recouvrement des pensions alimentaires, l’ARIPA, la question des pensions ne se poserait pas, cependant le recours à l’ARIPA repose encore sur le volontariat.
- Les revenus d’activité non salariée et les revenus de patrimoine de l’année N-2, communiqués par la DGFiP aux CAF et à la MSA.
Ainsi la contemporanéisation a permis d’après la Cour des comptes, de « gommer des situations d’aubaine, légales mais injustifiables » et a induit une économie substantielle, par ailleurs l’actualisation trimestrielle a « contribué mécaniquement à contenir l’évolution de la dépense globale en minorant le montant des aides versées, en application du barème légal », mais la contemporanéisation a également induit une complexification accrue tant au niveau de la prise en compte des ressources les plus variables que des conditions de réexamen du droit des aides personnelles au logement.
Ainsi certaines obligations déclaratives incombent désormais aux assurés alors qu’ils n’y étaient pas astreints auparavant, puisque la DGFiP faisait masse des informations à transférer et connue de l’année N-2. Ainsi « la proportion d’allocataires devant effectuer des déclarations trimestrielles ou annuelles a augmenté en raison de la diversité croissante des situations individuelles et des revenus non automatisables dans les flux d’information. » Elle concerne en particulier, les artistes-auteurs, les travailleurs frontaliers, les travailleurs indépendants installés depuis moins de 2 ans, certains gérants salariés et les micro-entrepreneurs, qui doivent désormais déclarer chaque mois leur chiffre d’affaires.
Cela a abouti à augmenter le volume des indus en raison des erreurs commises dans la déclaration des ressources ou des délais. Ainsi le volume d’indus passe-t-il de 5,8% en 2020 à 8,3% en 2021, soit de 1,7 Md€ à 2,68 Md€ et de 1,6 million de dossiers à 3,6 millions sur la même période. Les indus seraient cependant « stabilisés » et même en baisse avec 2,7 millions d’allocataires touchés en 2023.
Une augmentation de la fraude aux APL d’environ 34% entre 2020 et 2022 :
La Cour ne peut pas établir de lien de causalité entre l’augmentation de la fraude estimée aux APL et la réforme de la contemporanéisation, cependant celle-ci augmente bien entre 2020 et 2022 de 33,8%. En effet, l’enquête de la CNAF dite « paiement à bon droit et fraude » fait état d’une augmentation des indus potentiellement frauduleux estimés à partir de l’exploitation de 6000 dossiers – de 39%, les montants passants de 2,8 Md€ en 2020 à 3,9 Md€ en 2023 – soit un volume compris entre 4,4 à 5,5% du montant total des prestations. Sur ce total les fraudes aux aides au logement représenteraient 0,7 Md€. Le montant d’indus frauduleux estimé pour les seules aides au logement augmenterait de 33,8% entre 2020 et 2022.
Il n’y a pas de possibilité cependant d’en déduire un lien de causalité dans la mesure où contrairement à la CNAF, la CCMSA « mentionne quant à elle des prestations de nature frauduleuses en diminution à l’issue de la réforme, à hauteur de 59.200€ en 2022 contre 94.900€ en 2020 ». Pour la CCMSA les fraudes aux aides au logement représentent entre 4 et 7% du total des fraudes de la branche, suivant le type d’aides concernées.
Des évolutions nécessaires au niveau du back-office :
Si pour les bénéficiaires l’enjeu de simplification n’était au cœur de la réforme, il apparaît cependant que celle-ci pouvait apparaître initialement comme une application du principe « dites-le nous une fois ». En réalité l’opportunité était avant tout budgétaire, ce qui a abouti à proposer plutôt un « parcours sans couture » de signalement dans le cadre de l’adossement du dispositif au DRM comme le RSA et la prime d’activité. Cela milite pour plusieurs réformes :
- Poursuivre les travaux d’intégration de nouvelles ressources au sein du DRM (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, travailleurs frontaliers) ;
- Accélérer les processus déclaratifs des frais professionnels, avec l’ouverture d’une notification au fil de l’eau, qui pourrait être signalée de façon contemporaine à la DGFiP par l’employeur (les remboursements de l’employeur étant alors notifiés in itinere à l’administration fiscale).
- Automatiser l’usage de l’ARIPA pour le signalement des versements des pensions alimentaires – en rendant son truchement obligatoire ;
- Dépasser la logique d’évaluation de la fraude par risque pour lui ajouter une logique de contrôle par allocation. Aujourd’hui en effet il n’est pas possible d’évaluer finement les ressorts de la fraude en fonction de la nature des prestations versées (dont les APL), ce qui est une faiblesse pour les CAF.
Un gisement puissant de fraude, « institutionnelle » est celle générée par le contrôle de la vétusté des locaux. Les contrôles des locaux « conventionnés » et de la décence des logements occupés par les bénéficiaires. La COG 2023-2027 n’accorde à ce titre que 5 M€ pour financer ces actions. Pour autant le déploiement de la plateforme Signal Logement (ex-Histologe) permet la centralisation de tous les signalements (insalubrité, défauts structurels, indécence). Les bailleurs sociaux en particulier pourraient à ce titre être davantage contrôlés puisqu’ils possèdent une sorte de présomption de conformité de leurs habitats à ces critères après conventionnement. Le dispositif est pourtant efficace, mais d’une ampleur limitée puisque de 2000 conservations en 2019 il est passé à 5000 en 2023 au titre de l’ensemble des indécences. En 2023, parmi les 4100 sorties de conservation, 3990 faisait suite à une mise aux normes des logements dans les délais, soit 95%. Reste que l’effet volume devrait être largement accentué pour constituer un aiguillon suffisamment puissant à l’endroit des bailleurs.
Enfin on ne le dira jamais assez, mettre en place un dispositif de signalement analogue à celui des aviseurs fiscaux en matière sociale. La plupart des prérogatives d’enquête des services de contrôle sont identiques désormais entre celui des caisses de sécurité sociale et celui de la DGFiP. Dans la perspective de l’unification du recouvrement (forcé ou non) et du renforcement du partage d’information, disposer d’un dispositif analogue en matière sociale serait essentiel pour améliorer le ciblage des contrôles.
[1] https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-01/20250129-S2024-1417-Contemporaneisation-des-aides-
personnelles-au-logement.pdf