Référendum d’entreprise, ce qu'il faut faire
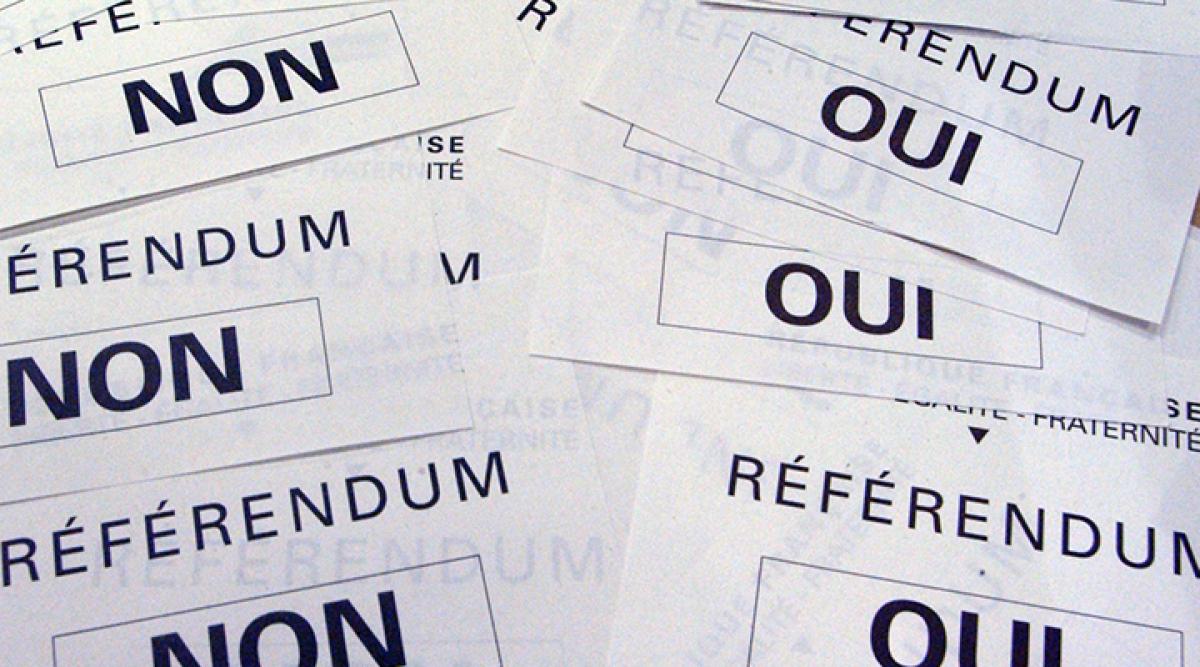
Le terme de référendum d’entreprise vient de jaillir soudain de façon inattendue, dans la bouche de la ministre du travail et à propos du blocage des accords d’entreprise que le droit de veto des syndicats majoritaires peut entraîner. Aussitôt on se prend de passion pour ce néologisme que l’on aimerait bien parer de toutes les vertus. On en est encore loin.
- Il faudrait commencer par ouvrir l’usage du référendum dans tous les cas où la tentative d’accord collectif aboutit à un échec, ce qui suppose au préalable de ne pas restreindre la possibilité de passer des accords collectifs dérogatoires à la loi ou aux accords de branche.
- Il faut d’autre part que l’initiative du référendum puisse aussi provenir de l’employeur et pas seulement des syndicats.
- Enfin le référendum devrait être ouvert sans restriction dans le cas des entreprises sans représentant des salariés, sans obligation de passer par le mandatement syndical.
Le référendum d’entreprise existe déjà dans le Code du travail en tant que porteur d’une valeur légale[1], mais seulement dans des cas précis et très limités[2]. Les accords collectifs, qui font l’objet des articles 2211 à 2283 du Code du travail, déterminent méticuleusement les conditions de la négociation collective, qui nécessite toujours de passer par l’intervention des organisations syndicales, qu’il s’agisse d’accords professionnels, d’accords de branche ou d’accords d’entreprise. En règle générale, les accords doivent recueillir la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des institutions représentatives du personnel, pour autant que les syndicats majoritaires n’aient pas fait valoir d’opposition[3].
Premier constat, le référendum d’entreprise ne peut être concevable qu’en cas d’échec de la négociation collective dans le cadre prévu par le Code du travail – sauf à bouleverser complètement l’organisation des droits des salariés, qui est garantie par la Constitution[4]. Toute modification ultérieure de la loi devra donc déterminer les conditions dans lesquelles l’échec des négociations pourra permettre de recourir à un référendum d’entreprise.
Un deuxième problème se pose à propos des cas dans lesquels le recours à des accords collectifs, et éventuellement à des référendums, est ouvert. Ce problème renvoie à la détermination des dispositions légales impératives par opposition à celles auxquelles les accords collectifs peuvent déroger. Le cas des 35 heures est aujourd’hui symptomatique. La durée « normale » du travail est fixée par la loi, et le Premier ministre a été clair sur le fait que les accords collectifs ne pourront qu’aménager les compensations offertes en cas de dépassement de cette durée, et non modifier le seuil à partir duquel les heures sont considérées comme supplémentaires.
La problématique des 35 heures est clarifiée. Le Premier ministre nous a gratifiés d’une présentation à la fois intéressante et conclusive sur la position du gouvernement quant au temps de travail. Ayant commencé par s’excuser avec le sourire d’avoir précédemment évoqué trop « hardiment » le « déverrouillage » des 35 heures, il précise néanmoins que ce déverrouillage a bien eu lieu, la meilleure preuve en étant… le fait que les Français travaillent effectivement en moyenne plus de 39 heures. Il continue en affirmant qu’il ne faut pas confondre « compensation » des heures supplémentaires et durée « normale » du travail. Pour lui, la durée normale du travail reste fixée à 35 heures, et donc la loi exigera qu’au-delà de 35 heures les salariés aient droit à une majoration de leur rémunération, même si elle laissera une certaine latitude aux entreprises, sous réserve d’un accord collectif, pour fixer le pourcentage de cette majoration. Ce qui n’empêche, a-t-il avancé expressis verbis qu’une autre majorité politique vienne ultérieurement fixer la durée normale du travail à « 39 ou 40 heures ». Auquel cas bien entendu, la majoration ne s’appliquerait qu’au-delà de cette nouvelle durée normale. Il est donc clair, ce qui devrait clore les débats sur le sujet, et particulièrement mettre fin aux annonces – ou plutôt aux hypothèses - faites par Emmanuel Macron à Davos, qu’il restera interdit aux entreprises de stipuler une majoration zéro, comme c’est le cas à l’heure actuelle où le minimum de majoration est de 10%. La seule différence serait alors, encore que ce ne soit pas certain, qu’un accord d’entreprise plus restrictif des droits des salariés pourrait contrevenir à une fixation par un accord de branche (par exemple 10% au lieu de 25% de majoration). Et c’est là qu’interviendrait éventuellement le référendum d’entreprise, en cas de désaccord entre syndicats (voir ci-dessus) Commentaire : Pays légal et pays réel. La réflexion qui vient à l’esprit est de s’étonner que, en même temps que le Premier ministre souligne que les Français travaillent en moyenne 39 heures, il maintienne la durée légale à 35 heures. Acte manqué, dû à la transcription forcée d’un diktat présidentiel ? Quoi qu’il en soit, Manuel Valls assume parfaitement que le pays légal n’ait jamais été accordé avec le pays réel et que la loi n’ait servi en réalité qu’à augmenter de plus de 11% (différence entre 35 et 39 heures augmenté de la majoration applicable) les salaires qu’il serait normal de payer si la durée légale avait suivi la durée effective. Les 35 heures n’ont évidemment pas pour objet de promouvoir la réduction du temps de travail comme un mode de partage de ce travail. Notons aussi que la règle s’applique à tous les salaires et notamment au smic – dont par ailleurs le gouvernement s’escrime à diminuer le coût en laissant à la solidarité nationale le soin de combler le déficit public qui en est la conséquence. On pénalise donc à la fois les entreprises et les contribuables, façon de donner au salaire minimum l’équivalent de plus de dix fois le « coup de pouce » que lui refuse avec constance le groupe d’experts désigné pour donner son avis. |
Deuxième constat, dans le système actuel, la loi devra être modifiée pour fixer un chiffre différent pour la durée du travail, au besoin en formulant les règles de paiement des heures supplémentaires et la latitude permise aux accords collectifs.
Troisième point, la porte n’a été qu’entrouverte par les récentes déclarations gouvernementales, dans la mesure où la ministre du travail ne compte autoriser le recours au référendum d’entreprise qu’aux syndicats eux-mêmes, et seulement à ceux ayant signé un accord d’entreprise recueillant 30% de suffrages.
Le fait que seuls les syndicats puissent mettre en œuvre un référendum d’entreprise fait toute la différence. Il transforme l’employeur en simple spectateur d’une lutte entre syndicats « réformistes » et les autres à l’occasion d’un accord à l’origine duquel cet employeur se trouve pourtant. Étrange évidemment. Le gouvernement échappe formellement à la critique de vouloir « contourner » les syndicats, mais c’est quand même la réalité de la situation, qui veut que l’on conteste la représentativité réelle des syndicats non réformistes. Il semble que ce soit le cas de la FNAC qui ait joué le rôle de la goutte d’eau, le gouvernement ayant été exaspéré de voir saboter sa réforme du travail dominical par le veto exercé à l’encontre d’un accord ayant pourtant recueilli 30% des suffrages syndicaux.
Troisième constat, il faudra donc ouvrir plus largement le recours au référendum, et en faire bénéficier les employeurs aussi bien que les représentants des salariés.
Enfin, le cas des entreprises où il n’existe pas de représentant des salariés est réglé de façon insatisfaisante par la loi. L’employeur est en effet obligé de discuter avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (article 2232-24 du Code du travail). Dans les TPE en particulier, l’employeur est contraint de supporter l’immixtion d’organisations complètement étrangères à l’entreprise, ce qui constitue un frein considéré comme insupportable. La disposition est ici censée protéger, bien au-delà de ce qui est nécessaire, les salariés systématiquement considérés comme la partie faible et incapable de négocier. Rappelons par exemple que dans les TPE allemandes les syndicats ne disposent d’aucun monopole de désignation au premier tour des élections.
Quatrième constat, il faudra modifier la loi pour supprimer cette exigence de mandatement par les organisations syndicales dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, afin, soit d’organiser une représentation ad hoc interne à l’entreprise et élue parmi ses salariés, soit plus simplement de permettre le recours direct au référendum.
On le voit, la porte n’a été qu’entrouverte, et beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour donner au référendum d’entreprise un rôle véritable. Est-ce à dire que la réforme envisagée ne constitue pas une avancée intéressante ? Les syndicats s’y opposent fermement, et on peut les comprendre de leur point de vue. Ils n’ont cependant à s’en prendre qu’à eux-mêmes de s’être donné des verges pour se faire fouetter, à l’occasion des deux cas récents que nous avons signalés, celui de Smart et celui de la FNAC. Le blocage y est en effet choquant. Et finalement le débat qui s’ouvre est une très bonne chose. C’est peut-être le premier signal qui va contraindre les syndicats issus du Congrès d’Amiens, dont on n’est pas obligé de célébrer le centenaire cette année, à évoluer et sortir de leur arrogance idéologique d’un autre âge. Car tous les gouvernements ont placé les syndicats au centre du dialogue social et n’ont de cesse d’augmenter leur rôle et leur mission. Cela suppose d’avoir des syndicats responsables, et non systématiquement fermés à toute évolution. Un pas énorme serait fait si l’attitude syndicale pouvait changer. On sait que des milliers d’accords collectifs sont quand même signés chaque année au niveau de l’entreprise. Mais les centrales sont toujours là pour bloquer les évolutions au niveau national, et nous avons toujours un Philippe Martinez, patron de la CGT, qui est opposé par principe à toute possibilité de dérogation au Code du travail, car pour lui « la loi doit être la même pour tous ».
[1] Nous ne traitons pas ici du référendum auquel les employeurs – comme les syndicats lorsqu’ils consultent leur base – font appel librement, mais qui n’ont aucune valeur légale. Ainsi, lorsque Smart a récemment voulu modifier la durée du travail dans son usine de Moselle, et qu’un accord collectif minoritaire a pu être signé mais immédiatement mis à néant par le véto des syndicats majoritaires. L’employeur a consulté, à deux reprises d’ailleurs, les salariés, mais sans aucun effet légal, puisqu’il a fallu obtenir la signature individuelle de chaque salarié pour rendre cette modification opérationnelle.
[2] Plans de participation et d’intéressement, régimes de prévoyance et de retraite surcomplémentaire, contrepartie à l’ouverture dominicale de magasins, approbation d’accords conclus avec un salarié mandaté par un syndicat en l’absence de représentant des salariés.
[3] Ce qui s’est récemment produit dans les cas de Smart (accord sur la durée du travail) et de la FNAC (accord sur le travail dominical).
[4] Points 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, intégré dans la constitution de 1958 : « 6.Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », et « 8.Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.»






