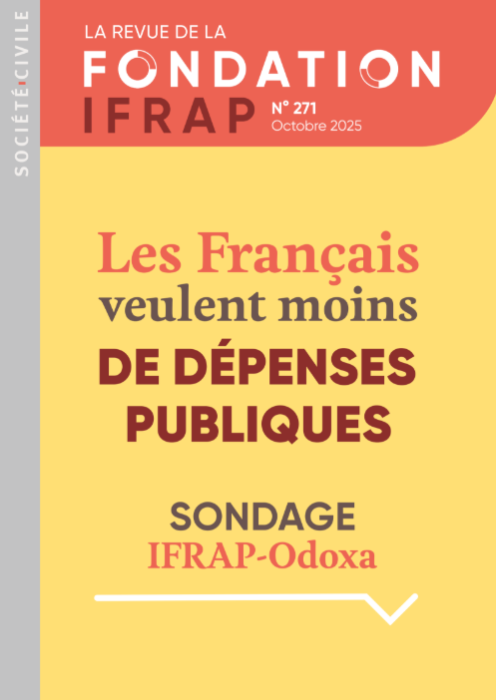Territoires zéro chômeurs, une expérimentation coûteuse pour les finances publiques

Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan et la DARES ont rendu public récemment (septembre 2025) le rapport d’évaluation de la deuxième phase de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD), dont ils assuraient le secrétariat du Comité Scientifique. Les conclusions s’agissant du coût pour les finances publiques sont explosives. Qu’on en juge : si l’effet causal sur le taux d’emploi est de +74 points de pourcentage en moyenne sur les 24 premiers mois, les coûts nets oscillent entre 11 300 € et 13 700 €/ETP/an, soit entre 40 % et 50 % du coût brut de la prise en charge des chômeurs de longue durée par le programme. « Loin de la neutralité budgétaire promise à l’origine par les porteurs de projets ». Il est donc faux de dire – en première analyse – comme l’affirmait péremptoirement les porteurs initiaux du projet que « le chômage d’exclusion sociale coûte plus cher à la collectivité que l’emploi, même lorsque l’emploi est cofinancé par la collectivité. » Si l’expérimentation, « inédite à bien des égards », aurait pu « combler un vide » du point de vue de l’efficacité globale des politiques d’insertion, en permettant de disposer « d’un instrument spécifique permettant de cibler les populations les plus fragiles », son coût financier net reste en réalité comparable aux coûts évités (entre 12 900 et 15 300 €/ETP/an). La perspective d’une « garantie de l’emploi » universelle reste donc utopique et devrait donc être abandonnée. Mais contre toute attente, ce n’est pas la position retenue par le comité scientifique d’évaluation qui propose d’accélérer le déploiement du processus et de mieux cibler les territoires et les personnes dans le cadre d’une vague n°3… et donc accepter une fuite en avant…
L’expérimentation « TZCLD », un dispositif innovant à plus d’un titre
L’expérimentation TZCLD prend sa source dans une expérimentation citoyenne, soutenue par des acteurs associatifs cherchant à construire une nouvelle brique de la politique d’insertion, en vue d’organiser « une véritable garantie de l’emploi ». Patrick Valentin, son initiateur, débuta en convainquant en 1993 une petite commune de moins de 3 000 habitants, Seiches-sur-Le-Loir (dans le Maine-et-Loire), de proposer à tous les chômeurs de longue durée de la commune des emplois rémunérés au SMIC. L’idée sera ensuite reprise vers 2010 par des associations comme ATD Quart Monde, le Secours Catholique, Emmaüs France, le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité. L’initiative sera finalement portée par deux associations : le Fonds ETCLD[1] (dit fonds Expérimentation) et l’association TZCLD[2]. L’expérimentation TZLCD est lancée en février 2016 via une première loi (1ère phase), suivie d’une seconde (2ème loi en décembre 2020), chacune votée à l’unanimité et selon un mode de fonctionnement rare, dans la mesure où l’Etat financeur principal de l’opération n’en est ni le promoteur, ni le maître d’œuvre et exerce sur elle finalement peu de contrôle. L’action se déploie selon deux axes :
En direction des territoires volontaires, où un espace délibératif est créé, le CLE (comité local pour l’emploi) ;
En direction des personnes privées durablement d’emploi dans ces mêmes territoires (PPDE) et auxquelles sont proposés des dispositifs d’insertion ou l’entrée en CDI dans une entreprise à but d’emploi (EBE).
Ainsi, alors que la vague 1 (2016-2021) avait permis l’habilitation de 10 territoires volontaires, ceux-ci en phase 2 (2021-2026) atteignent 83 territoires, regroupant près de 4 000 salariés dans 92 EBE à la mi-2025. Avec un triple but :
Identification (via le CLE) des activités socialement utiles pour les territoires, notamment les territoires administratifs les plus étroits... selon un principe de supplémentarité permettant de ne pas concurrencer l’activité locale déjà existante.
Permettre l’acquisition pour les PPDE d'un emploi stable, en CDI, à temps choisi dans un collectif de travail à proximité de leur domicile selon un principe d’exhaustivité (le dispositif est proposé à l’ensemble des PPDE identifiés sur le territoire).
Au niveau financier, réaliser cette initiative pour un coût minimal pour les finances publiques voir même dégager des économies (hors suivi et organisation de l’opération elle-même) puisque « le chômage d’exclusion sociale coûte plus cher à la collectivité que l’emploi même lorsque l’emploi est cofinancé par la collectivité. » (Patrick Valentin 2013). On verra que cette dernière assertion s’est révélée être, lors de l’expérimentation, beaucoup trop optimiste.
Différence et complémentarité entre les EBE et les SIAELes EBE (Entreprises à But d’Emploi) et les SIAE (Structures de l’Insertion par l’Activité Économique) diffèrent principalement dans leurs missions, les types de contrats proposés, les profils des personnes accompagnées et leurs objectifs. Les EBE, issues de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), visent une inclusion durable en proposant des CDI adaptés aux besoins locaux, sans limite de durée. Elles ciblent notamment les personnes en situation de handicap ou durablement éloignées de l’emploi. Les SIAE, en revanche, proposent des contrats temporaires (CDD, intérim) et accompagnent les personnes vers une réinsertion dans le marché du travail classique ou une formation qualifiante. Elles s’adressent à un public diversifié, confronté à des freins multiples (âge, précarité, santé). Les EBE et les SIAE sont complémentaires : les EBE privilégient le maintien durable dans l’emploi local, tandis que les SIAE se concentrent sur la transition vers le marché du travail classique. Tableau comparatif :
|
Des résultats expérimentaux très hétérogènes
Les TZCLD (territoires zéro chômeur de longue durée) sont extrêmement divers tant par leur surface que par leur caractère, urbain ou rural. Cela provient du fait que les véritables porteurs de l’action sont les élus locaux qui ont réussi le processus d’habilitation et qui président d’ailleurs les CLE (comités locaux pour l’emploi).
Un processus lourd et fastidieux pour les collectivités comme pour les bénéficiaires
Tout d’abord, il s’avère que le processus d’habilitation des territoires est long et coûteux pour les porteurs de projets locaux. Le portage politique local est en effet un prérequis de l’entrée en expérimentation, et nécessite « le soutien du département » qui dispose d’un droit de véto. Ainsi, « seule une minorité des territoires souhaitant participer remplissent ces conditions et parviennent au bout du processus de labellisation ». Par ailleurs, la procédure d’habilitation par le Fonds d’Expérimentation est « longue et exigeante », si bien qu’ « avec beaucoup de territoires candidats », on constate finalement « peu d’élus et donc un certain nombre de déçus ».
Du côté des 4 000 bénéficiaires salariés en EBE, l’attente peut être également longue, puisqu’il leur a été demandé d’être mobilisés dans des activités bénévoles en amont de la signature de leur contrat, avant de se voir rémunéré en CDI par les établissements employeurs. D’où, pour l’ensemble de l’expérimentation, « une impression de lourdeur institutionnelle et un risque de renforcement des inégalités territoriales » au profit des territoires disposant des meilleures ressources[3]. Un risque également au niveau des bénéficiaires puisque ces derniers sont sélectionnés parmi une population très éloignée de l’emploi mais uniquement sur la base du volontariat. Enfin, l’exhaustivité territoriale (atteinte de l’ensemble des publics cibles du territoire sans biais de sélection) repose sur des partenariats avec le service public de l’emploi (SPE : France Travail[4] aujourd’hui concrètement à partir de 2024).
Très concrètement, tout dépend du dynamisme des CLE. Ce sont eux qui doivent repérer et orienter les PPDE (personnes privées durablement d’emploi) en tenant à jour la liste de « mobilisation » et identifier les activités des EBE. Ce sont les CLE qui mène des méthodes d’aller-vers pour atteindre les publics les plus éloignés de l’emploi, puisque leur substituent ensuite des approches plus institutionnelles, une fois les candidatures recueillies.
Des publics éloignés de l’emploi volontaire, plutôt féminins, âgés et en situation de handicap
Les profils touchés sont atypiques par rapport aux autres personnes privées d’emploi de longue durée : « les salariés en EBE sont en moyenne plus âgés et plus souvent des femmes et des personnes en situation de handicap que les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) ». Le rapport constate que, les EBE octroyant aux bénéficiaires des CDI, intégrer cette structure devrait constituer un point de chute « seulement lorsqu’il est constaté que la personne n’est pas en capacité de rejoindre une action d’insertion ». D’autres structures aux contrats courts permettent une sortie dynamique, ouvrant vers un dispositif classique de réinsertion (ainsi pour les SIAE : CDD insertion, mission d’intérim (ETTI), travail occasionnel (AI) etc.).
Il en résulte que les personnes employées vers les EBE le sont généralement à titre définitif, sans possibilité de basculer à nouveau dans les dispositif de droit commun en matière de réinsertion. Les CDI délivrés servent donc de relai entre le chômage de longue durée, l’ASS, les minima sociaux de type RSA, et le basculement vers la retraite (ils servent en quelque sorte de dispositif public de préretraite). Les perspectives de réinsertion hors EBE sont donc très faibles voir inexistantes pour ces publics.
Les EBE, des structures ad hoc, au chiffre d’affaires faible et aux attentes contradictoires
Les EBE se distinguent assez nettement des SIAE (voir encadré ci-dessus). Ces structures développent par ailleurs leurs activités dans plusieurs secteurs, de 1 à 16 différents selon les entités. Certaines activités sont permanentes, d’autres saisonnières ou ponctuelles (en lien avec des commandes spécifiques). Les EBE se positionnent avant tout dans des activités de service (60 % de leur CA consolidé), et exercent leurs activités « dans les domaines de la maintenance des bâtiments, des paysages, les activités administratives et de soutien aux entreprises, le commerce et la réparation automobile, ainsi que les activités des organisations associatives ». Leurs activités reposent sur la polyvalence des salariés, ce qui permet de multiplier les postes adaptés pour les personnes handicapées.
Très dépendantes des subventions publiques, les EBE présentent une grande fragilité financière en lien avec leur très forte dépendance aux aides publiques. Cela rend le travail de leurs équipes de direction d’autant plus difficiles puisqu’ils doivent conjuguer :
Equilibre financier grâce au complément apporté par leurs activités marchandes ;
Développement des activités socialement utiles ;
Respect du principe de non-concurrence et de supplémentarité ;
Prise en compte des souhaits des salariés ;
Encadrement des équipes dont les membres présentent des troubles psychiques ou des addictions supposant un accompagnement spécifique.
Les effets sur le tissu économique de l’activité des EBE est imperceptible. D’une part, l’application du principe de non-concurrence et de supplémentarité des emplois évite de créer des externalités négatives vis-à-vis des autres acteurs économiques au plan local. D'autre part, « l’évaluation ne met pas en évidence un impact positif sur l’emploi et sur les salaires des autres habitants du territoire ». Il faut dire que la création de valeur marchande est faible, de l’ordre de 5 000 €/ETP/an.
Un coût financier non négligeable pour la collectivité
Le rapport montre très clairement que l’objectif de neutralité budgétaire voir même d’économies grâce à la valeur ajoutée créée n’est absolument pas atteint par l’expérimentation, contrairement aux convictions de ses initiateurs. Ainsi, « quelles que soient les hypothèses retenues, son coût net est supérieur aux 25 % de la dépense publique annoncés par les porteurs de projet : il se situe plutôt entre 40 % et 50 % », soit près du double.
Le coût brut de l’expérimentation en lien direct avec l’emploi d’un PPDE dans un EBE s’est élevé en 2023 à 26 600 €/ ETP/an. Il a ensuite légèrement baissé en 2024.
Coût par EQTP des PPDE en euros/an | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
| Contribution de l'Etat au développement de l'emploi (CDE Etat) | 20 142 | 20 873 | 20 212 |
| Fraction du SMIC correspondante | 102% | 100,25% | 95% |
| Contribution des conseil départementaux (CDE départements) | 3 021 | 3 131 | 3 032 |
| Fraction de la CDE Etat appliquée | 15% | 15% | 15% |
| Montant de la CDE par EQTP de PPDE (1) | 23 163 | 24 004 | 23 244 |
| Montant de la CDE des non PPDE par EQTP de PPDE (2) | 2 305 | 2 575 | 2 525 |
| Montant de la CDE par EQTP de PPDE (en tenant compte de la CDE des non-PPDE) (1)+ (2) | 25 468 | 26 579 | 25 769 |
| Dotation d'amorçage pour un ETP supplémentaire (facultatif) | 5 924 | 6 246 | 6 383 |
Source : Rapport comité scientifique.
On ne prend pas en compte dans l’évaluation la dotation d’amorçage qui n’intervient que pour financer un emploi supplémentaire en EBE lorsque le quota de PPDE est atteint. Les coûts évités peuvent être évalués ainsi :
Couts évites et recettes supplémentaires générées par l'entrée dans l'expérimentation en €/ EQTP | |
Effet par personne | |
| Allocation chômage (ARE/ASS) | 2 489 |
| RSA | 1 051 |
| AAH | 171 |
| APL | 288 |
| PPA | -413 |
| Total des économies individualisables | 3 586 |
| Contribution salariés | 2723 |
| Cotisations employeurs | 580 |
| Impôt sur le revenu | 367 |
| TVA | 837 |
| Total recettes individualisables | 4507 |
| Economies individualisables nettes | 8 093 |
| Soit pour un EQTP de PPDE (extension) | 12 094 |
Source : Rapport comité scientifique.
Ils s’élèvent à 12 094 € dans une acception étroite, l’IPP retenant une définition plus large mais moins décomposée, entre 12 900€ et 15 300 € par ETP. Il en résulte un coût net compris entre 11 300 et 13 700 €/ETP/an, auquel on peut ajouter la dotation d’amorçage dans certains cas.
Mais d’autres dépenses moins individualisables existent :
Le complément temporaire d’équilibre pour les EBE en difficulté : 555 527 € en 2024 pour 14 EBE aidés.
Les subventions supplémentaires aux EBE ne passant pas par le fonds ETCLD : 3,51 M€ en 2023.
Le budget de fonctionnement du fonds ETCLD (2,83 M€ en 2023, 3,1 M€ en 2024).
Les dépenses des équipes du projet financées par les collectivités : soit 2 024 €/an d’ETP de PPDE sur la période 2022-2024.
Les aides de l’Agefiph pour les travailleurs en situation de handicap ; pour 2024, 638 forfaits attribués pour des salariés dans 74 EBE, soit 1,9 M€. Depuis le début du partenariat, 1 746 forfaits pour un montant de 5,7 M€.
Une longue expérimentation menée avec le plus de groupes d’évaluations
L’expérimentation TZCLD est « l’une de celle qui a suscité un grand nombre de travaux de recherche ». Elle a par ailleurs mobilisé pas moins de 5 consortiums de chercheurs différents : Eval-Lab, IPP, ACME, Dynamit, SPEPE. Elle s’est d’ailleurs déployée dans la durée puisqu’elle est « en fait la plus longue expérimentation sociale jamais mise en œuvre en France » si l’on prend en compte la toute première expérimentation lancée par ATD Quart-Monde dans le cadre du Fonds d’Expérimentation jeunesse qui s’est tenue entre novembre 2013 et février 2016. Elle a donc suscité légitimement « des attentes fortes et des craintes de la part de nombreux acteurs de l’insertion ». Non sans difficultés en termes de neutralité méthodologique, puisque de l’aveu même du rapport de la mission d’évaluation : « le comité scientifique n’a pas souhaité mobiliser de façon extensive l’ensemble des études produites par le Fonds, l’association TZCLD et son Observatoire ». En effet, s’il a pris connaissance de ces travaux, « le comité a préféré rester à distance des résultats mis en avant par beaucoup de ces études [globalement favorables ndlr] (…) la proximité des auteurs avec les porteurs de projet ne constitue pas un gage d’indépendance et d’impartialité ». Par contre, le rapport souligne qu’en pratique et malgré la durée de l’entreprise, « le temps laissé aux chercheurs et aux équipes d’évaluateurs (…) est apparu finalement très limité (…) les équipes ont eu moins de 18 mois au total pour collecter leurs observations et pour les analyser avant de livrer leurs rapports ».
Ainsi, si le taux d’emploi en EBE des personnes privées durablement d’emploi (PPDE) aboutit à un effet causal de +74 points de pourcentage en moyenne sur les 24 premiers mois, « cet effet a un caractère mécanique et reflète essentiellement les effets du ciblage de l’action sur des personnes effectivement privées d’emploi ». De la même façon, on constate que le passage en EBE a un effet positif et durable sur la qualité de l’emploi et le revenu des salariés ainsi que sur le lien social. Alors que dans le même temps les personnes n’entrant pas en EBE « connaissent une hausse limitée de leur taux d’emploi », il s’agit d’ailleurs surtout de personnes atteintes de problème de santé mentale et d’addiction. Mais les cadres offerts, tels que les CDI à temps choisi, l'adaptation du collectif de travail, la multiplicité des tâches… sont des critères qui ne peuvent pas être trouvés dans les autres dispositifs d’insertions disponibles. Il existe donc des biais d’offre et de sélection. Enfin, on l’a vu plus haut, des coûts nets individuels « minimaux » pour les finances publiques (hors coûts annexes) sont de l’ordre de 40 % à 50 % des coûts bruts – sans oublier que les EBE sont également des entités très fragiles.
Conclusion : les EBE et les TZCLD, des dispositifs coûteux et une expérimentation à arrêter ?
Les EBE et les TZCLD constituent un « chaînon manquant » au sein de la palette de l’écosystème des dispositifs d’insertion. C’est sans doute pour cette raison que le rapport de la mission d’évaluation, malgré le coût individuel élevé (brut comme net) de l’expérimentation ne se résout pas à en proposer la suppression. Au contraire, le rapport en propose la pérennisation voire l’élargissement moyennant quelques recommandations qui passent entre autres par la rénovation du cahier des charges de l’expérimentation.
Préconiser une dotation de lancement offerte par l’Etat aux collectivités en phase d’habilitation afin de préparer leur candidature, de préfigurer leur CLE… « au prix d’un coût budgétaire accru » ;
Recentrer l’usage du CDI à temps choisi aux personnes les plus éloignées de l’emploi, l’entrée dans l’EBE devenant une solution de dernier recours ; (donc une meilleure articulation avec l’offre des SIAE pour les personnes encore formables et adaptable au marché de l’emploi de droit commun) ;
Elargir le périmètre d’intervention du CLE à l’ensemble des actions d’insertion afin de prévenir toute concurrence entre EBE et SIAE, en cohérence avec le réseau pour l’emploi créé par la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023.
L’impératif budgétaire en ces temps financiers difficiles est totalement relégué au second plan. L’analyse méthodique de l’expérimentation pourtant longue conduit cependant à interroger ses prémices : nul n’est inemployable (mais à quel prix et par qui ?), ce n’est pas le travail qui manque (mais si cela se produit en vertu uniquement du principe de supplémentarité et de non concurrence, cela en restreint d’autant la systématisation) ; la privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi… L’expérimentation montre de façon chiffrée et argumentée que non. Cette expérience invite le lecteur à réfléchir sur le processus de stratification des politiques publiques – même évaluées pendant 18 mois. La nécessité « politique » de disposer d’un outil manquant semble plus grande que l’impact de l’expérimentation en termes de finances publiques. Finalement, un portage éventuel du dispositif via des mécanismes de solidarité (mécénat d’entreprise, de particuliers etc.) par la générosité publique n’est même pas évoqué… Elle ferait concurrence aux associations qui en sont à l’origine.
[1] Le précisément le Fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée et territoires habilités.
[2] Association Territoires zéro chômeur de longue durée.
[3] Les territoires conservent en effet « une marge d’interprétation » « sur la définition de l’éligibilité à l’expérimentation ».
[4] Dans l’ensemble de ses déclinaisons : France Travail ex-Pôle Emploi en tant qu’opérateur, mais également les autres organismes participants du SPE : Bourse du Travail, Maisons de l’Emploi, missions locales etc. Voir https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/51-millions-le-rapport-france-travail-met-en-lumiere-le-vrai-nombre-de-demandeurs-demplois